I. Le droit temporaire au logement
Concernant le conjoint survivant
Il a le droit d'occuper pendant un an et gratuitement le logement familial,
- si ce dernier constituait son habitation principale au moment du décès de son époux,
- et si ce bien appartenait aux deux époux ou dépend totalement de la succession ou appartenait pour partie indivise au défunt (dans ce cas l'indemnité d'occupation est payée par la succession).
Si le bien était loué, les loyers sont remboursés par la succession au fur et à mesure de leur acquittement et ils peuvent être déduits de l'actif successoral.
La jouissance gratuite porte aussi sur le mobilier garnissant le logement.
On ne peut pas priver son conjoint du droit temporaire sur le logement.
Concernant le partenaire pacsé
Il bénéficie d'un droit temporaire au logement dans les mêmes conditions que le conjoint survivant.
II. Le droit viager au logement
Concernant le conjoint survivant
Il peut bénéficier sur le logement d'un droit d'habitation et du droit d'utiliser le mobilier le garnissant sa vie durant, dans les conditions suivantes :
- si ce logement appartenait exclusivement aux deux époux ou personnellement au défunt ;
- si le conjoint survivant occupait effectivement, au moment du décès de son conjoint, ce logement à titre de résidence principale.
Le conjoint survivant doit manifester sa volonté de bénéficier de ces droits dans un délai d'un an à compter du décès de son époux.
Le conjoint ou les autres héritiers peuvent exiger qu'il soit dressé un état de l'immeuble soumis au droit viager et un inventaire des meubles.
Lorsque le logement n'est plus adapté aux besoins du conjoint survivant, celui-ci peut le louer à usage d'habitation. Ce qui lui permet de financer un nouvel hébergement conforme à ses besoins.
Si un conjoint veut priver son époux de son droit viager au logement, il ne peut le faire que par un testament établi par un notaire.
La valeur des droits d'habitation s'impute sur les droits successoraux recueillis par le conjoint survivant. Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. Si la valeur est supérieure, il n'est pas tenu d'indemniser la succession à raison de l'excédent.
Concernant le partenaire pacsé
Il ne bénéficie pas du droit viager au logement.
Le concubin ne bénéficie légalement d'aucun de ces deux droits.
III. Le maintien dans les lieux
Lorsque le couple louait un appartement ou une maison, le survivant peut rester dans les lieux, dans les mêmes conditions, jusqu'à la fin du bail.
Concernant les époux et les partenaires
Le bail est transféré au survivant sans aucune condition de durée de cohabitation.
Concernant les concubins
Le bail n'est transféré au survivant que sous deux conditions :
- le concubinage doit être notoire : le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple et cette union doit être publique et connue de tous..
- le concubin notoire doit avoir vécu pendant un an au moins avec son compagnon ou sa compagne avant son décès.
Le concubinage constitue une situation de fait qui peut être prouvée par tous moyens, les juges appréciant souverainement l'existence du concubinage et sa notoriété.
IV. Le conjoint survivant peut ne prendre qu'une partie de l'héritage : "le cantonnement"
Qu'est-ce-que le cantonnement ?
Il s'agit de la faculté pour le conjoint survivant bénéficiaire d'une donation au dernier vivant ou d'un testament ou pour un légataire de limiter ses droits à une partie seulement de ce qu'il doit recevoir dans la succession.
Dans quels cas le cantonnement est-il possible ?
Il doit exister un testament ou une donation au dernier des vivants.
Le défunt ne doit pas avoir privé le bénéficiaire de la faculté de cantonner.
Il faut qu'au moins un héritier ait accepté la succession.
Quelles sont les conséquences du cantonnement ?
Le cantonnement ne constitue pas une donation faite par celui qui cantonne aux autres héritiers.
Une fois le cantonnement effectué, chacun paiera des droits de succession en fonction de la part d'héritage qu'il reçoit et de son lien de parenté avec le défunt.



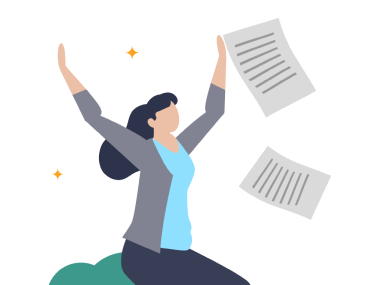






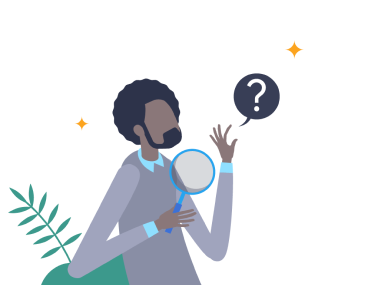

Globalement un très bon travail. Néanmoins quelques questions restent pour moi en suspens: 1 - Lorsqu'il employeur effectue la demande d'embauche d'un étranger, celui-ci doit-il être domicilié dans le département de la préfecture auprès...