Qu'est-ce qu'une rupture transactionnelle ?
⚠ Il est avant tout nécessaire de faire une clarification : la notion de rupture transactionnelle n'existe pas juridiquement, elle n'est présente dans aucun texte de loi.
Il s'agit d'une expression issue du langage courant qui n'a aucune signification juridique, et qui sème une confusion entre deux dispositifs :
- l'accord transactionnel : il est question d'un contrat de transaction entre l'employeur et le salarié, qui, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou préviennent une contestation à naître (1) ;
- la rupture conventionnelle (RC) : il s'agit d'un mode de rupture du contrat de travail où l'employeur et le salarié, qui ne sont pas forcément en mauvais termes, vont se mettre d'accord pour mettre fin à leur relation de travail. Le salarié va bénéficier d'une indemnité de rupture conventionnelle (qui n'est pas une transaction) (2).
Parler de "rupture transactionnelle" n'est donc pas suffisamment précis pour renvoyer à l'un ou l'autre de ces mécanismes. Vous n'obtiendrez pas une rupture de votre contrat de travail en demandant à votre employeur de négocier une transaction.
🔍Exemple 1 - la rupture conventionnelle : Laurent n'a rien à reprocher à son entreprise, mais souhaite quitter son emploi pour une reconversion professionnelle. Il veut néanmoins bénéficier des allocations chômages, ce qui n'est pas possible en démissionnant. Il va alors négocier, avec son employeur, une rupture conventionnelle, qui lui permet de rompre le contrat et de toucher le chômage, si un terrain d'entente est trouvé avec son employeur.
🔍Exemple 2 - la transaction : Sam a été licenciée et souhaite saisir le conseil de prud'hommes afin de contester la décision de son employeur car selon elle, son employeur n'a pas respecté la procédure adéquate (ou elle conteste le fait d'avoir commis une faute, etc.). Finalement, afin d'éviter une procédure judiciaire potentiellement longue et coûteuse, son employeur et elle se mettent d'accord sur un accord transactionnel dans le but de mettre fin à leur conflit sans passer devant le juge.
Quelles sont les principales différences entre rupture conventionnelle et transaction ?
Nous l'avons vu, l'objectif de la rupture conventionnelle est différent de celui de la transaction, car la première constitue un mode de rupture du contrat de travail, tandis que la transaction est un mode de règlement amiable des litiges qui opposent salarié et employeur après la rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle : mode de rupture du contrat à l'amiable
⏰Vous négociez avant la rupture du contrat de travail.
La rupture conventionnelle est une alternative lorsque l'on réfléchit à démissionner de son CDI (contrat à durée indéterminée), seulement si les deux parties (employeur et salarié) acceptent de convenir de la fin du contrat et de ses modalités.
💡 Ce mode de rupture du contrat n'est ouvert qu'aux CDI, puisque les contrats à durée déterminée prennent fin naturellement à leur échéance.
L'employeur peut également faire, auprès de vous, une demande de rupture conventionnelle. Dans ce cas, il s'agit d'une alternative au licenciement.
La rupture conventionnelle est un accord amiable sur la fin du contrat de travail : négociation, date de la rupture, montant de l'indemnité de départ... Toutefois, ce mode de rupture ne peut pas être imposé par l'une ou l'autre des parties.
L'existence d'un différend entre vous et l'employeur n'affecte pas la validité de la conclusion d'une convention de rupture, mais il conviendra d'être vigilant à ce que le consentement des parties ne soit pas vicié (1).
Une fois que la convention de rupture est homologuée (ou autorisée dans le cadre de la rupture conventionnelle d'un salarié protégé), le contrat de travail prend fin. L'employeur est libéré de ses obligations, et le salarié perçoit son indemnité de rupture conventionnelle.
L'accord transactionnel : une indemnité transactionnelle en cas de litige employeur/salarié (licenciement, etc.)
⏰La transaction doit être signée après la rupture du contrat de travail.
Comme énoncé précédemment, la transaction est l'accord grâce auquel les parties au contrat de travail (employeur et salarié) règlent un conflit qui les oppose. Leurs négociations font l'objet d'un accord (ou protocole) transactionnel.
📌 La transaction porte sur un différend relatif au bien-fondé, à la nature de la rupture de votre contrat, à ses conséquences pécuniaires ou à une mauvaise exécution du contrat. Il est important d'insister sur le fait que cet accord intervient nécessairement après la rupture du contrat de travail. Dans ce cas là, il ne sera donc pas nécessaire d'attendre la fin du contrat pour signer l'accord.
🔍 A noter que rien n'empêche une transaction d'être conclue en dehors de toute procédure de rupture du contrat de travail, bien que ce soit rare, si elle ne concerne que la bonne exécution du contrat (par exemple un conflit concernant la pose des congés payés). Dans ce cas là il ne sera donc pas nécessaire d'attendre la fin du contrat pour signer l'accord.
Par l'accord transactionnel, vous vous mettez d'accord, avec votre employeur, pour régler vos différends à l'amiable. L'idée générale, pour les parties, est d'éviter d'avoir à porter un conflit devant le juge. Généralement, le salarié ne cherche pas à voir son employeur condamné mais souhaite seulement obtenir réparation. Pour l'employeur, cela peut-être l'occasion de régler un litige rapidement, et de ne pas ternir l'image de l'entreprise.
L'homologation du protocole transactionnel lui confère une force exécutoire entre les parties.
Enfin, signer une transaction avec votre employeur peut vous permettre de percevoir une indemnité transactionnelle.
💡Vous êtes employeur ? Pensez à la transaction pour régler vos litiges avec vos salariés et téléchargez notre modèle de protocole d'accord transactionnel
Que choisir entre rupture conventionnelle ou transaction ? Avantages et inconvénients (indemnité, chômage, procédure, préavis, régime social, etc.)
| Transaction | Rupture conventionnelle | |
| 1/Initiative de la rupture | Hors mode de rupture | Salarié ou employeur, d'un commun d'accord (2) |
| 2/Nécessité de justifier d'un motif de recours | Oui Objectif : mettre fin à une contestation née ou à naître (3) | Non |
| 3/Entretiens | Oui Cependant, elle ne peut pas se négocier durant l'entretien préalable au licenciement | Oui Un ou plusieurs entretiens avec possibilité de se faire assister (4) |
| 4/Formalisme | Oui Accord écrit signé (3) | Oui Convention écrite signée homologuée par la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) (5) |
| 5/Préavis | Non La transaction est possible dès lors que le contrat de travail est rompu (6) | Non Rupture possible dès le lendemain de l'homologation (7) |
| 6/Indemnités | Oui Indemnité transactionnelle : montant non dérisoire, possiblement exonéré d'impôt* (8) | Oui Indemnité spécifique de rupture conventionnelle (au moins égale à l'indemnité légale de licenciement) (7) |
| 7/Droit de percevoir les allocations chômage | Ne dépend pas de la transaction car fonction du motif de rupture | Oui, le salarié peut toucher le chômage |
| 8/Possibilité de contestation | Non (les parties se sont mis d'accord pour renoncer à une action en justice) (9) Sauf consentement vicié ou absence de concessions réciproques entre les parties (application du droit des obligations) | Oui Attention : dans un délai de 12 mois (10) |
* Cette exonération ne vaut que si l'Administration et le Juge (lorsqu'il est saisi) estiment que les sommes versées ont pour objet de réparer un préjudice subi par le salarié, autre qu'une perte de salaire (comme le paiement des heures supplémentaires).
Le point commun entre ces deux cas est qu'il est nécessaire de négocier avec votre employeur (la rupture, ou le règlement d'un différend).
Comment convaincre votre employeur de conclure une rupture conventionnelle ?
Plus de 130.300 RCau second trimestre 2025 (11)
Si vous envisagez de rompre votre contrat de travail, vous pouvez demander une rupture conventionnelle. Il sera par contre nécessaire de convaincre votre employeur pour que ce dernier accepte d'engager la procédure. En effet, une rupture conventionnelle peut également lui apporter des avantages.
Un tel mode de rupture de contrat peut être pris en considération même lorsque les relations avec votre employeur deviennent conflictuelles. De plus, la rupture conventionnelle n'a pas à être motivée. Si votre employeur a par exemple l'intention de vous licencier, cela peut vous donner l'occasion de lui proposer une rupture amiable qui vous épargnerait mutuellement le stress d'une procédure de licenciement.
Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'un mode de rupture du contrat de travail à l'amiable, entre le salarié et l'employeur, il est possible d'organiser et de prévoir la date de rupture effective (en tenant compte des délais légaux de rétractation et d'instruction), ce qui va permettre une bonne transmission des savoirs en recrutant un nouveau salarié. L'entreprise ne pâtira donc pas d'une désorganisation.
À retenir : la rupture conventionnelle présente des avantages indéniables que sont le droit au chômage (indépendamment de qui est à son initiative) et la perception d'une indemnité de rupture, mais présente également l'inconvénient de devoir être acceptée par votre employeur. Une demande bien préparée aura plus de chances d'aboutir.
💡Cet article peut vous intéresser : Lettre ou mail de rupture conventionnelle : comment faire votre demande de rupture conventionnelle en 4 étapes ?
Peut-on conclure un protocole d'accord transactionnel après une rupture conventionnelle ? Quels sont les cas où cela est interdit ?
Si vous avez conclu une rupture conventionnelle, il vous est possible de demander une transaction à la suite de celle-ci, puisqu'il s'agit de deux dispositifs différents. En effet, certains points litigieux entre vous et l'employeur sont peut être restés en suspend malgré l'accord pour mettre un terme au contrat.
La transaction doit être postérieure à la rupture conventionnelle
Chronologiquement, la transaction ne peut pas avoir lieu au moment de la signature de la rupture conventionnelle, sous peine de nullité de la transaction. Elle ne peut avoir lieu que postérieurement à l'homologation de celle-ci.
Autrement dit :
- la rupture conventionnelle va permettre de rompre le contrat de travail ;
- tandis que la transaction va intervenir dans la situation où les parties ont besoin de régler des litiges potentiels nés après la rupture. Elles acceptent alors des concessions réciproques, et notamment le versement d'une somme d'argent par l'employeur au salarié (indemnité transactionnelle).
La transaction ne peut porter sur un sujet déjà abordé dans la convention de rupture conventionnelle
La Cour de cassation a également posé la condition suivante : pour être valide, la transaction doit avoir pour objet de régler un différend portant sur des éléments relatifs à l'exécution du contrat non compris dans la convention de rupture, et non pas sur la rupture en elle-même (12).
Quel est le montant de l'indemnité pour un accord transactionnel conclu après votre départ de l'entreprise ? Comment est-il possible de le négocier ?
L'indemnité de rupture conventionnelle perçue et le montant de la transaction sont deux sommes différentes. Autrement dit, il n'est pas possible pour votre employeur de baisser le montant de la transaction en raison du montant de l'indemnité conventionnelle perçue au préalable.
De plus, le montant de la transaction dépendra de la négociation entre vous et votre employeur, aucun montant minimum ou maximum n'est imposé aux parties.
💰 Dans tous les cas, ce montant ne doit pas être dérisoire.
Références :
(1) Cass. Soc. 15 novembre 2023, n°22-16.957
(2) Article L1237-11 du Code du travail
(3) Article 2044 du Code civil
(4) Article L1237-12 du Code du travail
(5) Articles L1237-13 et L1237-14 du Code du travail
(6) Cass. Soc. 4 janvier 2000, n°97-41591
(7) Article L1237-13 du Code du travail
(8) Cass. Soc. 28 novembre 2000, n°98-43635 et Cons. Const. QPC du 20 septembre 2013, n°2013-340
(9) Article 2048 et 2052 du Code civil
(10) Article L1237-14 du Code du travail
(11) "Les ruptures conventionnelles", données de la Dares, 9 octobre 2025
(12) Cass. Soc. 26 mars 2014, n°12-21136 et Cass. Soc. 16 juin 2021, n°19-26083

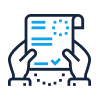

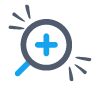

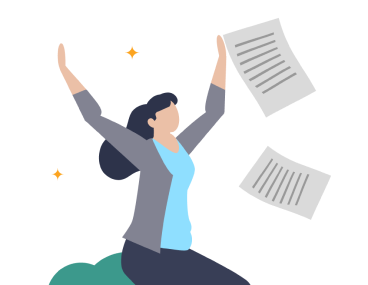




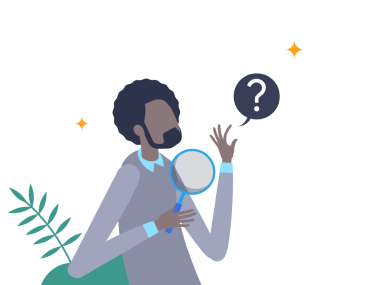

Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement