Selon votre besoin, Juritravail vous propose deux services :
- consultez un avocat disponible immédiatement par téléphone,
- ou bien recevez des devis d'avocats compétents près de chez vous afin de rencontrer celui qui vous convient.

Affiner votre recherche :
Supprimer tous les filtres
Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 03/02/2026
Le métier que vous exercez ne répond plus à vos attentes. Vous avez envie de changer de cap et vous envisagez une reconversion professionnelle. Pourquoi ne pas donner un nouveau souffle à votre carrière professionnelle en réalisant un bilan de compétences ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 03/02/2026
Le secteur de la coiffure relève de la Convention collective nationale (CCN) de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (IDCC 2596), qui prévoit des dispositions particulières en matière de jours fériés. Un employeur de ce secteur peut-il envisager d'ouvrir son salon et de demander à ses salariés de travailler un jour férié ? Réponse !

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 03/02/2026
Le mois de janvier 2026 a été marqué par plusieurs évolutions juridiques ! En tant qu'employeur, ou membre du service RH, vous devez impérativement connaître toutes les évolutions qui pourraient impacter votre activité ! Qu'avez-vous manqué depuis le début d'année ? Juritravail revient sur les actualités juridiques essentielles du mois de janvier 2026 !

Rédigé par Paul Augustin Cissé, mis à jour le 03/02/2026
Votre enfant de 6 à 18 ans a fait sa rentrée scolaire et les frais à engager vous inquiètent ? Vous remplissez peut-être les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette aide financière peut vous aider à couvrir une partie des dépenses de la rentrée. Détails et explications !

Rédigé par Noa Lelaidier, mis à jour le 03/02/2026
Vous intervenez auprès des mineurs et adultes handicapés en protection sociale/jeunesse ? Vous accompagnez des personnes en difficultés sociales ? Vous relevez certainement de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, communément appelée "Convention 66". Nous faisons le point sur les dispositions prévues par votre convention...

Rédigé par Sessi Imorou, mis à jour le 02/02/2026
Votre salarié ne supporte plus son travail, une tâche en particulier ne l'enchante peut-être plus, il n'a plus envie d'obéir à vos recommandations ? Vous y voyez une insubordination ? L'insubordination du salarié peut être lourde de conséquences. Vous pouvez sanctionner cette indiscipline, voire décider de licencier pour faute. Dans certains cas, le licenciement pour faute grave est...
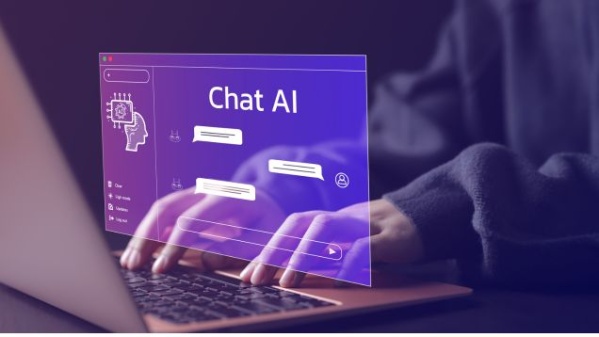
Rédigé par Kevin Lemoyec, mis à jour le 02/02/2026
Si 2025 s'est imposée comme l'année du développement technologique massif des Intelligences Artificielles (IA), avec des investissements colossaux dans des modèles de langage comme ChatGPT, Gemini ou Mistral AI, l'année 2026 marque un tournant opérationnel avec une intégration concrète de l'IA dans de nombreux secteurs d'activité. Toutefois, ce virage technologique ne se fait pas sans...

Rédigé par Paul Augustin Cissé, mis à jour le 02/02/2026
La rentrée des classes est un moment particulier pour les salariés qui ont des enfants. Vous avez déjà reçu des demandes d'absence ou d'aménagement d'horaires de la part de salariés parents pour le jour de la rentrée scolaire : devez-vous forcément les accepter ? De quelle marge de manœuvre disposez-vous en la matière ? Quels réflexes adopter ? Comment anticiper ce moment ?...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 30/01/2026
Vous avez été victime d’un accident ou d’une maladie non professionnelle et avez été reconnu invalide. Votre capacité de travail s’en trouve réduite, entraînant une baisse de revenus. Pour compenser cette perte, vous pouvez prétendre à une pension d’invalidité. On vous dit tout à ce sujet !

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 30/01/2026
Si l'évaluation des risques de l'entreprise est faite sous la responsabilité de l'employeur, le Comité social et économique (CSE) est aussi un acteur incontournable dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) . Quel est le rôle du CSE vis-à-vis de l'élaboration et de la mise à jour du DUERP ? Faisons le point ensemble.

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 30/01/2026
Le report des congés payés non pris par le salarié n'est pas toujours possible. En principe, lorsque le salarié ne prend pas ses jours de congés avant la date limite fixée par son entreprise, il les perd. Néanmoins, des cas exceptionnels permettent le report des jours qui n'ont pas été posés. Dans quels cas le report des congés payés est-il possible ? Pendant combien de temps...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 30/01/2026
Lors de la rupture de son contrat de travail, le salarié peut prétendre à différentes indemnités, dont l'indemnité compensatrice de congés payés. L’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) est due quand un salarié n’a pas pris tous ses congés à la fin du contrat. Dans quels cas est-elle versée ? Le mode de rupture influe-t-il sur son versement ? Quelle est la formule...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 30/01/2026
Vous envisagez de licencier un salarié ? Quels sont les types de licenciement possibles ? Quel motif de licenciement choisir (licenciement pour motif personnel ou licenciement pour motif économique) ? Quel est le coût pour votre entreprise ? Quels sont les risques ? Voici un panorama des différents motifs de licenciement pour vous aider à prendre une décision.

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 29/01/2026
La question de l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie et du report des congés payés non pris en raison d'un arrêt de travail, a fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour de cassation mettant fin à certaines divergences existantes entre le droit français et le droit européen en la matière, obligeant le législateur français à revoir sa copie. C'est chose faite,...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 29/01/2026
Le 14 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, dans l'espoir de faire adopter le texte avant la fin de l'année 2025. Pensé pour permettre de réduire le déficit public, celui-ci a donné lieu à de longs débats parlementaires. Que contient exactement ce PLF pour 2026 ? Quelles sont les mesures intéressant les entreprises ? Et les...

Rédigé par Sessi Imorou, mis à jour le 29/01/2026
Lorsque le salarié ne respecte pas ses obligations, l'employeur peut être contraint d'envisager de le licencier. Selon la gravité des faits, vous pensez à le licencier pour faute simple. Mais qu'est-ce qu'un licenciement pour faute simple ? Quelle procédure faut-il respecter et quelles indemnités devez-vous lui verser ? Explications.

Rédigé par Sessi Imorou, mis à jour le 29/01/2026
Le licenciement pour faute grave est une rupture du contrat de travail motivée par un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise, sans préavis ni indemnité de licenciement. Pour l’employeur souhaitant engager un licenciement pour faute grave, il est indispensable de respecter rigoureusement la procédure prévue à cet effet et de pouvoir justifier...

Rédigé par Cabinet Ziegler et Associés, mis à jour le 29/01/2026
Les arnaques financières en ligne sont de plus en plus courantes et sophistiquées. Elles peuvent prendre différentes formes, allant des escroqueries à l’investissement aux fraudes bancaires ou encore des arnaques aux identités. Face à ces pratiques de plus en plus habiles, il est essentiel d’adopter les bons gestes et réflexes pour éviter d’être victime de ces...

Rédigé par Cabinet Alexandre MARCHAND, mis à jour le 29/01/2026
Lorsque le contrat est conclu suite à un échange des consentements, il en résulte des droits et obligations pour les parties, que chacun doit exécuter amiablement et à défaut, la sanction judiciaire est possible et ce sera le sens de cette note.

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 29/01/2026
Les dates de départ en congés payés des salariés doivent être prévues à l'avance afin de permettre à l’employeur d’assurer la continuité de l’activité. Combien de jours de congés payés un salarié peut-il prendre ? Comment est fixée la période de prise des congés ? L'employeur peut-il établir un ordre des départs ? Peut-il refuser la demande de congés d'un salarié ou...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 29/01/2026
Au cours de la période d'essai, le salarié ou l'employeur peut rompre librement le contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Néanmoins, les droits du salarié en termes d'allocations chômage ne sont pas les mêmes, selon la partie à l'origine de la rupture, la date à laquelle elle intervient... et même la nature de la rupture de son précédent contrat de travail ! Alors, dans...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 29/01/2026
La rupture de la relation contractuelle à l’initiative de l’employeur peut intervenir dans des situations dans lesquelles le salarié a commis une faute lourde. Cette qualification repose sur des critères stricts. Mais comment déterminer si les faits reprochés à un salarié relèvent effectivement de cette catégorie de faute ? Quels sont les éléments qui permettent de caractériser...

Rédigé par Yoan El Hadjjam, mis à jour le 29/01/2026
Dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, l'employeur peut, dans les cas les plus graves, prendre la décision de mettre fin à la relation de travail qui le lie au salarié. Dans cette hypothèse, il doit respecter la procédure de licenciement disciplinaire. Pour quels types de fautes cette procédure est justifiée ? Quelle est la procédure à suivre ? Le salarié peut-il contester le...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 28/01/2026
Vous êtes employeur, et vous vous interrogez sur l'opportunité d'embaucher un apprenti afin de le former et de pouvoir envisager, à terme, de le recruter de manière définitive ? Sachez que le recrutement d'un apprenti peut vous donner droit à une aide financière ! Il est néanmoins nécessaire de remplir l'ensemble des conditions nécessaires pour cela. Quelles sont-elles exactement ?...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 28/01/2026
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui permet de suivre, par alternance, des périodes de formation en entreprise et en centre de formation d’apprentis. Quelles sont les parties au contrat d'apprentissage ? Comment embaucher un apprenti ? Quelles sont les aides à la disposition des employeurs ? Notre article fait le point !

Rédigé par Estelle Villain, mis à jour le 28/01/2026
Vous êtes employeur et souhaitez embaucher un apprenti dans votre entreprise. Pourquoi ne pas opter pour l'apprentissage aménagé pour les apprentis en situation de handicap ? Vous avez la possibilité de bénéficier d'aides financières, disponibles tant dans le secteur privé que public. En plus de cela, c'est une opportunité pour vous, employeur, de vous sensibiliser sur les bienfaits...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 28/01/2026
Que vous soyez employeur ou salarié, vous souhaitez proposer à l'autre partie de conclure une rupture conventionnelle mais ne savez pas comment vous y prendre. Quelle procédure respecter ? Y a-t-il un préavis à respecter ? Quelles sont les indemnités de rupture ? Qu'en est-il du chômage ? Quels sont les avantages et inconvénients ? On vous explique tout à travers ce guide sur la...

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 28/01/2026
En tant qu'employeur, vous devez assurer la sécurité de vos salariés. Pour ce faire, vous êtes dans l'obligation de procéder à la rédaction du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Comment élaborer un DUERP conforme au Code du travail ? Quels risques y inscrire et comment l'élaborer ? Quand le mettre à jour ? À qui doit-il être communiqué...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 28/01/2026
En tant que salarié, vous bénéficiez de congés payés. Votre employeur a l’obligation de vous permettre d’en profiter dans les meilleures conditions. Mais vous vous interrogez peut-être encore : combien de jours pouvez-vous acquérir ? Comment les poser ? Jusqu’à quelle date pouvez-vous les utiliser ? Faisons le point ensemble pour 2026.

Rédigé par Martial Moukagni-Nziengui, mis à jour le 28/01/2026
La loi visant à encadrer la location des meublés de tourisme de type Airbnb a été promulguée le 19 novembre 2024. Aussi appelée "loi anti-Airbnb", elle met en place divers outils visant à réguler les locations de courte durée, dans le but de rééquilibrer le marché locatif de longue durée. Voici un aperçu (non-exhaustif) de ses dispositions essentielles !

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 28/01/2026
Mode amiable de rupture de contrat entre l'employeur et le salarié, la rupture conventionnelle a vu le régime social de l'indemnité spécifique qui lui est liée, modifié depuis le 1er septembre 2023. Si le recours à ce type de rupture a augmenté au cours du dernier trimestre de l'année passée*, la tendance pourrait-elle s'inverser ? Possible, au vu du nouveau taux de contribution...

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 28/01/2026
Votre accord d'entreprise négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives ne correspond plus aux besoins de votre entreprise, de vos salariés, ni même à l'évolution de votre structure. Vous souhaitez donc y mettre un terme. Découvrez, sans plus attendre, tout ce qu'il faut savoir pour dénoncer un accord d'entreprise et le rendre inapplicable !

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 27/01/2026
L'apprentissage est un dispositif permettant aux employeurs de transmettre leur savoir-faire et de former de futurs travailleurs. C'est une solution qui permet aux jeunes de 16 à 29 ans, de se former à l'exercice d'un métier, en alternant formation théorique et pratique. Pour embaucher un apprenti, l'entreprise doit conclure un contrat d'apprentissage. En tant qu'employeur, vous souhaitez...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 27/01/2026
Blocage de la circulation, manifestations.. Les années 2024, 2025 et 2026 ont été fortement marquées par la colère grandissante des agriculteurs et des producteurs. Pour répondre à leur mobilisation et à leurs revendications, le Gouvernement a récemment annoncé une série de mesures de soutien, dont voici le détail !

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 27/01/2026
Entre les dispositions issues de la négociation collective, les dispositions supplétives (applicables à défaut de stipulation dans une convention ou un accord) et celles d'ordre public (auxquelles on ne peut déroger), gérer les congés payés peut s'avérer complexe. Période de prise des congés, fixation de l'ordre des départs, fractionnement des congés payés ou fermeture de...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 27/01/2026
Lorsqu'un salarié souhaite poser des congés payés, son employeur peut tout à fait refuser sa demande. Pour quelles raisons a-t-il le droit de refuser ? Que risque le salarié à partir en vacances quand même, l'employeur peut-il le sanctionner ? Dans quels cas le salarié peut-il contester le refus de l'employeur ? Voici tout ce que vous devez savoir, employeurs comme salariés, sur le...

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 27/01/2026
Vous êtes employeur ou salarié dans une entreprise de propreté ou de services associés ? Vous vous demandez quel est le salaire minimum prévu par la convention collective (CCN) ? Évolution des grilles de salaires en 2025 et 2026 (le 1er juin 2025 et durant l'année 2026), taux horaire d'un salarié du secteur du nettoyage, passage d'un échelon ASC à ASP... Découvrez également les...

Rédigé par Estelle Villain, mis à jour le 27/01/2026
Le visa Vacances-Travail (VVT) est un titre de séjour long séjour délivré aux jeunes de certains pays, permettant de vivre en France jusqu'à un an et d'y travailler sans autorisation de travail préalable. Ce programme permet de découvrir la culture d'un pays, tout en travaillant, et vise à assurer la stabilité financière du ressortissant étranger. Le visa délivré dans le cadre de...

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 27/01/2026
Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur est tenu de procéder à certaines démarches, dont celle de déclarer le nouveau recruté. La déclaration préalable à l'embauche (DPAE, ex DUE) est soumise au respect de délais et de modalités pratiques encadrées. Comment faire pour remplir et transmettre une DPAE ? Est-il possible de la modifier ou de l'annuler ? Que risquez-vous en cas de...
.jpeg)
Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 26/01/2026
Depuis l'entrée en vigueur de la Loi du 22 avril 2024, les salariés en arrêt de travail non professionnel acquièrent des jours de congés payés pendant leur arrêt de travail. Régulièrement, la Cour de cassation rend des décisions qui permettent de préciser le contour des règles issues de la Loi DDADUE. Dernièrement, la Cour de cassation a répondu à la question pratique suivante :...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 26/01/2026
La prime d'activité est une aide financière, versée par la Caisse d'Allocations familiales (Caf) ou par la Mutualité sociale agricole (Msa). Elle permet de compléter les ressources des personnes ayant de faibles revenus, malgré l'exercice d'une activité professionnelle. Conditions pour en bénéficier, montant pour l'année 2026, mode de calcul, demande, versement, voici tout ce que...

Rédigé par Clémentine Fontaine, mis à jour le 26/01/2026
Vous êtes un professionnel et vous êtes amené à conclure divers contrats de prestation de services. Ceux-ci constituent un accord commercial par lequel un prestataire (vous-même) s’engage à réaliser une mission contre rémunération. Quelles mentions essentielles ces contrats doivent-ils contenir ? Quels réflexes adopter dans le cadre de leur signature ? Définition du contrat de...

Rédigé par Paul Augustin Cissé, mis à jour le 23/01/2026
Les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier estival est particulièrement développé rencontrent des difficultés de recrutement (hôtellerie, sociétés d’assistance, etc.). Amélioration de l’attractivité des offres, évolutions à venir, nature du contrat à envisager pour attirer les saisonniers et flexibilité : nous faisons le point.

Rédigé par Yoan El Hadjjam, mis à jour le 23/01/2026
Lorsque le salarié est en télétravail, il peut être exposé à des dépenses dans le cadre de son travail. Ces frais engagés par le salarié peuvent avoir le caractère de frais professionnels, sous conditions. Doivent-ils être obligatoirement pris en charge par l'employeur ? Quelles sont les dépenses remboursables et sous quelle forme est alors versée l'indemnité ? Le salarié...

Rédigé par Cabinet JMP Avocat Indemnisation, mis à jour le 23/01/2026
Vous venez d'être victime d'un accident corporel causé par une autre personne. Dans le stress et la douleur qui suivent, une question revient souvent : devez-vous porter plainte ? Cette interrogation traduit une confusion fréquente entre deux domaines distincts du droit français : le droit pénal et le droit civil. Comprendre cette différence est essentiel pour prendre les bonnes...
Vous pourriez être intéressé par ces documents
Ils partagent leurs expériences
26/01/2026
document clair et complet
26/01/2026
Le lien du téléchargement est bien indiqué et pas de problème pour télécharger le document. Le pdf commandé est bien, tout y est. Bien rédigé, claire et assez compréhensible.
25/01/2026
J’ai acheté la convention 3123 en téléchargement
25/01/2026
excellent pour la pension invalidité
24/01/2026
Réponses claires et sourcées Parfait