La procédure à respecter par l’administration avant la notification d’un arrêté
Le préfet doit envoyer un courrier à l’exploitant contenant notamment les éléments suivants :
- informer l’intéressé des raisons de la mesure envisagée ;
- l’inviter formellement à produire des observations écrites, et éventuellement orales, dans un délai fixé (1).
Cela suppose donc de laisser un temps suffisant au commerçant pour faire valoir ses arguments. Un délai de 15 jours est couramment considéré comme adéquat pour respecter les droits de la défense.
Il est évidemment conseillé de se faire assister par un avocat dès réception de cette première lettre, car son intervention peut limiter, voire éviter la sanction, et donc préserver le chiffre d’affaires. Il est même préférable d’agir en amont, dès le début du contrôle réalisé par les agents de la préfecture ou de la mairie.
Un délai inférieur à 15 jours laissé à l’exploitant est en principe sanctionné par la juridiction administrative.
📌 Par exemple, un délai de 2 jours n’a pas été justifié par le préfet, mais le juge a tout de même validé la mesure, estimant que le commerçant n’avait pas démontré son impossibilité de répondre dans ce délai, un mois s’étant écoulé entre la demande d’observations du 23 juin 2021 et l’arrêté de fermeture du 20 juillet 2021 (2).
Les cas dans lesquels la procédure contradictoire peut être écartée
La procédure n’a pas à être respectée dans trois cas précis :
- en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles (3) ;
- si la mise en œuvre de cette procédure met en danger l’ordre public ou les relations internationales (3) ;
- si un texte législatif prévoit une procédure contradictoire particulière (3).
Fondements et durées possibles de l’arrêté
L’arrêté peut être motivé par :
- une infraction aux lois régissant l’activité commerciale : durée maximale de 6 mois. Le préfet doit auparavant adresser un avertissement. Cet avertissement peut suffire à remplacer l’arrêté si le manquement reste isolé ;
- une atteinte à l’ordre public, la santé, la moralité ou la tranquillité : durée maximale de 2 mois ;
- la commission d’infractions pénales en lien avec l’activité ou la fréquentation du commerce : durée maximale de 6 mois. Dans ce cas, le permis d’exploitation est automatiquement annulé (4).
Le ministre de l’Intérieur peut, dans les deux premiers cas, imposer la fermeture d’un établissement pour une période allant de 3 mois à 1 an. Toutefois, la durée prononcée par le préfet est déduite de celle du ministre (5).
Lorsque des manquements sanitaires ou d’hygiène présentent un danger pour la santé publique, le préfet peut ordonner la fermeture du local en imposant la réalisation de travaux. Le commerce ne pourra rouvrir qu’une fois les travaux achevés (exemple : présence de nuisibles, absence de formation du personnel à l’hygiène, non-respect des DLC…).
Le préfet peut aussi empêcher l’accès aux lieux, notamment dans un hôtel, jusqu’à l’exécution des travaux (6). Il peut également saisir le parquet pour une enquête pénale (exemple : conditions de logement inhumaines, mise en danger d’autrui), et demander à titre conservatoire la saisie des loyers sur le compte de l’exploitant, sous validation du juge des libertés.
Si les travaux incombent à l’exploitant, celui-ci peut les faire exécuter et réclamer leur remboursement au bailleur, si le local n’était pas conforme à l’usage prévu (exemple : absence de conduit d’extraction alors que le bail autorise une activité de restauration).
Cette règle s’applique aussi dans les relations entre bailleur et locataire-gérant. Il est alors fondamental d’identifier l’origine des infractions pour savoir qui doit les assumer. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a condamné un loueur de fonds à rembourser l’exploitant locataire-gérant pour des travaux dus à l’inadéquation du local avec les règles d’hygiène, au titre de son obligation de délivrance (7).
Exemples courants de motifs de fermeture
Parmi les causes fréquentes, on retrouve notamment, des violences survenues dans ou à proximité de l’établissement, impliquant des clients, le personnel ou les exploitants eux-mêmes.
Références :
(1) Article L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration
(2) TA Lyon – 7e chambre – 16 déc. 2022 – n° 2106508
(3) Article L121-2 du Code des relations entre le public et l'administration
(4) Article L3332-15 du Code de la santé publique
(5) Article L3332-16 du Code de la santé publique
(6) Article 1331-22 du Code de la santé publique
(7) CA Paris, 10 avril 2019, n° 17/11987




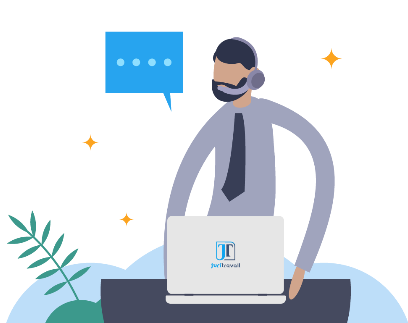




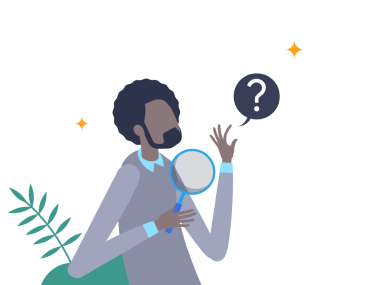

Réponses claires et sourcées Parfait