Le droit de grève en France : définition
Principe et caractéristiques
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que la grève est un droit qui s'exerce “dans le cadre des lois qui le réglementent".
⚖ Pourtant, il n'existe que très peu de textes en la matière concernant le secteur privé. C'est donc la jurisprudence qui a progressivement fixé les conditions d'exercice du droit de grève.
Pour qu'un arrêt de travail soit qualifié de grève, différents éléments doivent être réunis (1) :
- une cessation totale, collective (au moins 2 salariés) et concertée du travail ;
- l'objectif d'appuyer des revendications professionnelles.
Interdiction de certains mouvements collectifs particuliers (grève perlée, etc.)
📌 À noter : certains mouvements collectifs, tels que la "grève perlée", c'est-à-dire, un ralentissement volontaire du travail ou un accomplissement volontairement défectueux de l'activité, sont interdits.
Comment doit s'organiser une grève : modalités d'accomplissement (déclaration, préavis...) ?
Un salarié doit-il se déclarer gréviste ? Comment doit-il faire, le cas échéant ?
Dans le secteur privé, une grève peut être amorcée sans préavis (délai de prévenance).
Les salariés ne sont ainsi pas tenus d'informer l'employeur de leur intention d'exercer leur droit de grève, mais celui-ci doit néanmoins connaître les revendications professionnelles des salariés au moment du déclenchement du mouvement (2).
🔍 Si aucune tentative de conciliation préalable n'est obligatoire, les conflits collectifs intervenant entre les salariés et les employeurs doivent toutefois faire l'objet de négociations lorsque (3) :
- les conventions ou accords collectifs applicables comportent des dispositions à cet effet ;
- les parties intéressées en prennent l'initiative.
Blocage : un gréviste peut-il (ou non) rester sur son lieu de travail et occuper les locaux ?
Non : le droit de grève ne confère pas aux grévistes la possibilité de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise. Une occupation de ce type donnerait le droit à l'employeur d'obtenir l'expulsion des occupants grévistes (5).
🔍 Toutefois, la Cour de cassation reconnaît que ne constitue pas un acte abusif l'occupation des lieux de travail (6) :
- symbolique et momentanée ;
- et qui n'entrave pas la liberté du travail des non-gréviste.
L'occupation du lieu de travail, dès lors qu'elle porte atteinte à la liberté de travail des salariés non grévistes, constitue un trouble manifestement illicite. Dans une telle hypothèse, vous disposez, en tant qu'employeur, de moyens pour agir.
🔍 Bon à savoir : quoi qu'il en soit, vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des grévistes.
Les effets de la grève : suspension du contrat de travail des salariés grévistes
Suspension du contrat de travail : les grévistes sont-ils payés pendant la durée de la grève ?
Tout travail accompli avant ou après la grève, doit être rémunéré (7). En revanche, vous n'avez pas l'obligation de verser le salaire correspondant à la période de grève puisque l'exercice du droit de grève par un salarié suspend l'exécution du contrat de travail (8).
Lorsque vous effectuez une retenue sur le salaire d'un salarié gréviste, veillez à ce que cette réduction soit strictement proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail (9). Procéder à une réduction de rémunération supérieure à la durée de l'arrêt de travail est en effet interdit.
Il est également interdit, dans le cadre de la détermination de la retenue de salaire, de prendre en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services et les conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise. Il s'agirait d'une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève (10).
🔍 Bon à savoir : il existe néanmoins des cas justifiant le paiement de l'intégralité de leur salaire aux grévistes, par exemple lorsque la grève intervient en raison de manquements graves et délibérés de l'employeur à ses obligations.
Comment effectuer une réduction de salaire ?
Pour être proportionnelle à la durée de l'interruption de travail, la réduction de salaire doit être calculée sur l'horaire mensuel des salariés (11).
📊 Par exemple, un salarié payé 3.000 euros brut par mois (pour un horaire mensuel de 140 h : 35 h/semaine ×4) fait grève pendant 2 jours (14 h).
Le taux horaire est 3.000 euros / 140 h ≈ 21,43 euros, soit une retenue de 14 × 21,43 euros = 300 euros.
Son salaire est donc réduit de 300 euros brut, proportionnellement aux heures non travaillées.
📌 À noter : la réduction sur salaire présentant un caractère forfaitaire s'apparenterait à une sanction pécuniaire prohibée (12).
Par ailleurs, il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés (13).
Protection des salariés grévistes contre la rupture de leur contrat de travail
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié, sauf en cas de faute lourde (pour un fait commis au cours ou à l'occasion de l'exercice d'un droit de grève) qui lui serait imputable (14).
Tout licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions (c'est-à-dire, en l'absence de faute lourde) serait nul de plein droit (15).
💡Sur le même sujet, cette actualité pourrait vous intéresser : Quels sont les différents types de fautes professionnelles ? Tableau récapitulatif
Le rôle des représentants du personnel pendant le mouvement de grève : leur mandat est-il suspendu ?
Non. Si la grève suspend le contrat de travail des salariés, le mandat des représentants du personnel - membres élus au comité social et économique (CSE, délégué syndical...) - quant à lui, se poursuit. Il n'est pas suspendu, que le représentant du personnel soit lui-même gréviste ou non. Ainsi, il doit continuer à exercer ses fonctions représentatives.
Le représentant du personnel peut exercer son droit de grève comme n'importe quel autre salarié.
Si le représentant est lui-même gréviste, son contrat de travail est suspendu comme n'importe quel autre salarié gréviste, avec les conséquences que cela implique.
🔍 Bon à savoir : dans un contexte de grève, le représentant est en droit d'utiliser ses heures de délégation.
De plus, ce dernier demeure, et encore davantage en période de conflit collectif, l'interlocuteur privilégié de l'employeur en matière de dialogue social. Il doit continuer à être informé et consulté lorsque cela s'avère nécessaire.
Il a également la possibilité de continuer à échanger avec les salariés non grévistes dans le cadre de ses missions habituelles, notamment en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité.
💡Cette actualité pourrait vous intéresser : Le référent santé et sécurité au travail : tout savoir
Pour cela, il dispose de la liberté de circuler dans l'entreprise pour exercer ses missions et l'employeur ne peut s'opposer à sa présence dans les locaux (sauf abus de droit de la part du représentant du personnel qui fait grève), au risque de commettre un délit d'entrave au fonctionnement du CSE.
🚨 Rappel : en tant qu'employeur, vous êtes le garant de la sécurité des salariés de votre entreprise, même en temps de grève. Votre responsabilité pouvant être engagée sur ce terrain, vous devez donc prendre les mesures nécessaires pour que cette sécurité soit assurée. Les représentants du personnel peuvent vous accompagner dans cette démarche.
Réagir face à un mouvement de grève : quelles sont les obligations de l'employeur ?
L'obligation de fournir du travail aux salariés non-grévistes
Leur contrat de travail n'étant pas suspendu, vous restez tenu de fournir du travail et de rémunérer les salariés non-grévistes, sauf si vous justifiez d'une situation contraignante vous en ayant empêché (16).
Quelles actions peuvent être envisagées par l'employeur pour assurer la continuité de son activité pendant la grève ?
Un employeur, privé d'une partie de son équipe, peut se retrouver dans l'impossibilité de fournir du travail aux collaborateurs de l'entreprise, et par là-même, de respecter ses propres obligations contractuelles.
Il se peut aussi qu'un manager se retrouve en difficulté, en cas de grève, même avec une équipe au complet, à cause de la paralysie d'une partie de la chaîne de production.
L'interdiction de procéder à des remplacements en externe
La réaction première, en cas de mouvement collectif, est souvent celle de penser au remplacement des grévistes. Néanmoins, il faut savoir que la loi impose des restrictions en la matière.
Dans le but d'éviter que l'action des grévistes perde en efficacité, il est en effet interdit de recourir :
- au travail temporaire (17) ;
- aux contrats à durée déterminée (CDD), sauf exception (18).
D'ailleurs, les intérimaires présents, même engagés avant l'annonce du mouvement de grève, ne sont pas non plus mobilisables pour pallier l'absence des grévistes (19).
La possibilité de muter temporairement des salariés et d'avoir recours à des heures supplémentaires
Dans le cadre de votre pouvoir de direction, vous pouvez cependant muter, temporairement, un salarié non gréviste au poste d'un salarié en grève à qualification/compétence similaire et avec maintien de sa rémunération contractuelle (20).
Tout manager peut demander aux salariés non grévistes d'effectuer des heures supplémentaires.
Le recours à des contrats de sous-traitance
Vous êtes en droit de conclure des contrats de sous-traitance pour faire réaliser une partie de l'activité de l'entreprise.
💡Téléchargez notre modèle de contrat de sous-traitance prêt à l'emploi !
Recours à des bénévoles
Toujours dans le but d'assurer la continuité de l'activité, vous pouvez accepter le concours de bénévoles pour remplacer des salariés grévistes (21).
Peut-on réquisitionner un salarié gréviste ?
Si la réquisition n'est, par principe, pas limitée qu'aux services publics, les cas sont exceptionnels dans le privé.
En pratique, il faut qu'il y ait une atteinte suffisamment grave soit à la continuité du service public, soit à la satisfaction des besoins de la population pour qu'un tel procédé puisse être mis en place.
🔍 Il appartient, dans ce cas, au préfet du département de prendre les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public (22).
En effet, aucune disposition légale ne donne le droit à l'employeur de réquisitionner des salariés grévistes pour assurer un service minimum de sécurité dans l'entreprise.
💡Pour en savoir plus sur les obligations de l’employeur lors d'une grève, téléchargez notre dossier : Grève des salariés : réagir et gérer les impacts pour votre entreprise
L'employeur peut-il fermer l'entreprise en période de grève ?
L'action de l'employeur qui consiste à fermer temporairement l'entreprise ou un service lorsque la poursuite d'une activité normale est rendue impossible à cause de la grève constitue ce que l'on appelle un "lock-out".
L'accès aux locaux ou aux lieux de travail est alors refusé aux salariés de l'entreprise, grévistes comme non-grévistes.
Le "lock-out" est en principe irrégulier puisqu'il traduit un manquement de l'employeur à son obligation contractuelle de fournir du travail aux salariés non-grévistes.
Toutefois, il peut être considéré comme licite dans certains cas exceptionnels.
🔍 Exemple : un employeur a mis l’ensemble de ses salariés en chômage technique pendant une grève soudaine, non annoncée, qui paralysait une activité vitale de production, sans laisser le temps de réaffecter les non-grévistes. La Cour de cassation a jugé qu’il s’agissait d’une situation contraignante équivalente à un cas de force majeure, autorisant une fermeture licite de l’entreprise (23).
Le point sur les propositions de loi visant à restreindre la liberté du droit de grève dans le secteur des transports
Contexte
📆 En avril 2024, le Sénat avait adopté une proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève (24).
Le projet souhaitait instaurer la possibilité, pour le Gouvernement, de prévoir des périodes (30 jours maximum par an) pendant lesquelles les salariés indispensables au bon fonctionnement des services publics de transports (terrestres ou ferroviaires) n'auraient pas pu faire grève, sur certaines tranches horaires.
📃 Avancement de l'examen du texte : la constitutionnalité de cette proposition de loi a été mise en doute, et le Gouvernement de l'époque n'y était pas favorable. De fait, elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale.
📆 En novembre 2024, une autre proposition de loi visant à restreindre la possibilité d'exercice du droit de grève dans le secteur des transports (25) a été déposée à l'Assemblée nationale.
Le texte prévoyait l'impossibilité, pour les personnels des secteurs public et privé des transports en commun, d'exercer leur droit de grève :
- la veille et jusqu'au lendemain des jours fériés ;
- les 2 premiers et les 2 derniers jours de chaque période de vacances scolaires.
📃 Avancement de l'examen du texte : le texte a été renvoyé à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.
Une dernière proposition déposée en décembre 2024
📆 Une nouvelle proposition de loi visant à interdire les grèves dans le secteur des transports lors des vacances scolaires et périodes de forte affluence, a été déposée à l'Assemblée nationale en décembre 2024 (26).
Le texte prévoit l'impossibilité, pour les personnels des secteurs public et privé des transports en commun, d'exercer leur droit de grève :
- pendant les vacances scolaires ;
- pendant les week-ends prolongés ;
- pendant les jours fériés.
📃 Avancement de l'examen du texte : le texte a été renvoyé à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Affaire à suivre...
(1) Cass. Soc. 16 mai 1989, n°85-43359
(2) Cass. Soc. 22 octobre 2014, n°13-19858
(3) Article L2521-2 du Code du travail
(4) Article L2522-1 du Code du travail
(5) Cass. Soc. 21 juin 1984, n°82-16596
(6) Cass. Soc. 26 février 1992, n°90-40760
(7) Cass. Soc. 16 mai 1989, n°86-43399
(8) Cass. Soc. 8 juillet 1992, n°89-42563
(9) Cass. Soc. 8 juill. 1992, n°89-42563
(10) Cass. Soc. 9 juillet 2015, n°14-12779
(11) Cass. Soc. 19 mai 1998, n°97-41900
(12) Cass. Soc. 7 janvier 1988, n°84-42448
(13) Article R3243-4 du Code du travail
(14) Article L2511-1 du Code du travail
(15) Cass. Soc. 23 novembre 2022, n°21-19722
(16) Cass. Soc. 11 mars 1992, n°90-42817
(17) Article L1251-10 du Code du travail
(18) Article L1242-6 du Code du travail
(19) Cass. Soc. 2 mars 2011, n°10-13634
(20) Cass. Soc. 15 février 1979, n°76-14527
(21) Cass. Soc. 11 janvier 2000, n°97-22025
(22) Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales
(23) Notamment Cass. Soc. 18 janvier 1979, n°77-40982
(24) Proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à concilier la continuité du service public de transports avec l’exercice du droit de grève, n°2453
(25) Proposition de loi, visant à interdire les grèves dans les transports en commun la veille des vacances scolaires et les jours fériés, n°602
(26) Proposition de loi, visant à interdire les grèves dans le secteur des transports lors des vacances scolaires et périodes de forte affluence, n°650

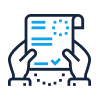



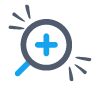

.jpg)

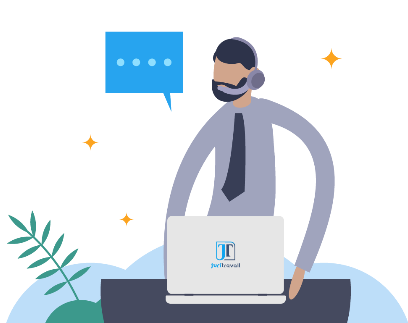




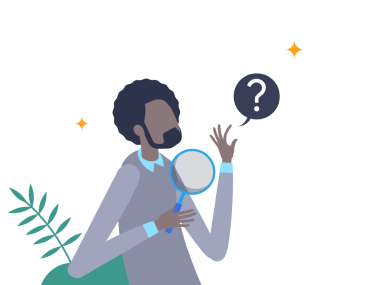

Réponses claires et sourcées Parfait