Redressement judiciaire : dans quel cas cette procédure a-t-elle vocation à se mettre en place ?
La procédure de redressement judiciaire fait partie des procédures dites "collectives" de traitement des difficultés des entreprises, au même titre que les procédures de sauvegarde et de liquidation judiciaire.
Le caractère collectif de la procédure découle du fait que celle-ci concerne l'entreprise ainsi que l'ensemble de ses créanciers.
🔍 Cette actualité pourrait aussi vous intéresser : Entreprise en difficulté : le plan d'actions du Gouvernement pour sortir de la crise
Conditions d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Toute personne (physique ou morale, de type société - SARL, SAS, etc.) exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole, et toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante peut faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire si elle remplit les 2 conditions cumulatives suivantes (1) :
- elle est en état de cessation des paiements, ce qui signifie, en pratique, qu'elle ne peut plus faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
- sa situation financière et économique n'est pas définitivement compromise, il existe une issue. Les difficultés rencontrées sont momentanées. Il est donc possible de ne pas avoir recours à une liquidation judiciaire.
🔍 Vous pourriez avoir besoin de notre Lettre accompagnant une déclaration de cessation des paiements
La nécessaire déclaration de cessation des paiements
Concrètement, lorsqu'une entreprise est en état de cessation des paiements (= dépôt de bilan), le débiteur personne physique (s'il s'agit d'un entrepreneur individuel) ou son représentant légal (dans le cas d'une société) a l'obligation, sauf exception, d'effectuer une déclaration de cessation de paiement dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, auprès du tribunal compétent (judiciaire, ou de commerce) selon la nature de l'activité de l'entreprise (2) ou du tribunal des affaires économiques si l'entreprise est située dans le ressort d'un tribunal concerné par l'expérimentation (3).
Après avoir fait un examen de la situation de l'entreprise, le tribunal procède à l'ouverture, selon la situation :
- d'une procédure de redressement judiciaire ;
- d'une procédure de liquidation judiciaire, si la situation de l'entreprise apparaît irrémédiablement compromise.
📌 À noter : sauf exceptions, la procédure de redressement judiciaire peut aussi s'ouvrir sur assignation d'un créancier de l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez notre dossier dédié !
Redressement judiciaire : quelles étapes ?
Le jugement d'ouverture d'une procédure judiciaire : la désignation des organes
Si toutes les conditions sont réunies, et après avoir entendu le débiteur à huis-clos, le tribunal judiciaire/de commerce/des affaires économiques va rendre un jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ce jugement d'ouverture donne notamment lieu à la désignation d'organes afin de prendre part à l'administration de l'entreprise :
- d'un ou de plusieurs administrateurs judiciaires, dont la mission est de veiller au bon déroulement de la procédure et de prendre en charge, dans la mesure de leurs pouvoirs, la gestion de l'entreprise ;
- d'un mandataire judiciaire, dont la mission est de vérifier l'état du passif (= des dettes) de la société et de veiller à la défense des intérêts des créanciers.
L'ouverture d'une période d'observation : combien de temps dure-t-elle ?
Suite au jugement d'ouverture, une période dite "d'observation" commence. Celle-ci est destinée à permettre aux organes de la procédure d'évaluer l'entreprise, de diagnostiquer ses difficultés, et d'élaborer, en lien avec le chef d'entreprise, un plan de redressement judiciaire (ou plan de continuation).
En pratique, la période d'observation est fixée pour une durée de 6 mois maximum, mais peut, sur décision du juge, être prolongée de la même durée, sans toutefois pouvoir dépasser la limite de 18 mois (4).
Des mesures conservatoires peuvent être prises par l'administrateur judiciaire, comme, par exemple, la saisie de certains biens du chef d'entreprise.
Celui-ci est aussi chargé de dresser un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise (5).
La poursuite de l'activité et la gestion de l'entreprise pendant la période d'observation
Tout au long de la période d'observation, l'entreprise poursuit son activité, sauf exceptions (6).
La gestion de celle-ci peut rester entre les mains du dirigeant de l'entreprise, ou alors être confiée à l'administrateur judiciaire, si le juge l'estime nécessaire (7).
Concrètement, l'administrateur désigné peut être chargé d'assurer, totalement seul, l'administration de l'entreprise ou avoir simplement une mission d'assistance. Dans le cas où l'administrateur nommé est chargé de l'administration de l'entreprise, le chef d'entreprise perd tous ses pouvoirs.
L'élaboration et l'adoption d'un plan de redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire a pour objectif principal l'élaboration d'un plan de redressement (8). Celui-ci permet donc la poursuite de l'activité de l'entreprise, mais aussi le maintien de l'emploi et le paiement du passif.
Quelle suite après un redressement judiciaire ?
Le plan de redressement prévoit généralement un échelonnement précis des dettes à régler. Si le redressement de la situation apparaît comme manifestement inenvisageable et que l'entreprise n'est pas viable, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise. Par conséquent, la procédure a la possibilité d'être convertie en procédure de liquidation judiciaire.
Plus rarement, la procédure de redressement judiciaire peut se clore par anticipation si l'entreprise dispose de suffisamment d'actifs pour désintéresser ses créanciers et régler ses frais.
Les conséquences de la procédure de redressement judiciaire pour les créanciers
Tous les créanciers de l'entreprise sont, en principe, concernés par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Ils sont tous représentés par le mandataire judiciaire désigné par le juge, et ont l'interdiction, dès l'ouverture de la procédure, d'engager des poursuites individuelles à l'encontre de l'entreprise (9).
C'est ce que l'on appelle le principe d'interruption des poursuites contre le débiteur de la procédure.
Quelles sont les conséquences de la mise en place d'une procédure de redressement judiciaire pour les salariés ?
L'impact de la procédure de redressement judiciaire ne se limite pas aux seuls créanciers, les salariés étant également affectés par les difficultés de l'entreprise.
Tout salarié d'une entreprise placée en procédure de redressement judiciaire bénéficie de la garantie de paiement de ses salaires par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) (10). Concrètement, celle-ci vise à ce que les rémunérations de toute nature pour les 60 derniers jours de travail soient assurées.
Cette assurance est financée par une cotisation patronale obligatoire.
🔍 Découvrez notre article sur le paiement des salaires en cas de redressement judiciaire
La procédure de traitement de sortie de crise est réactivée jusque fin 2025 !
Pour rappel, une procédure de traitement de sortie de crise a été mise en place au profit des entreprises de moins de 20 salariés touchées par la crise économique découlant de l'épidémie de Covid-19.
Sur ce sujet, cette actualité pourrait aussi vous intéresser : Arrêt maladie, délai et jours de carence : vos droits et la procédure
Celle-ci vise à favoriser le rebond rapide des petites entreprises en difficulté, à travers une restructuration de leurs dettes. La rapidité de cette procédure dérogatoire en est le grand avantage. En effet, contrairement au redressement judiciaire, la procédure de traitement de sortie de crise dispose d'une période d'observation de 3 mois maximum.
En raison du contexte économique, la Loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027 vient de réactiver cette procédure jusqu'au 21 novembre 2025 (11).
🔍 Pour en savoir plus sur la question, consultez notre actualité dédiée : Tout savoir sur la procédure collective dite "de traitement de sortie de crise"
(1) Articles L631-1 et L631-2 du Code de commerce
(2) Articles L631-4 et R631-1 du Code de commerce
(3) Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques
(4) Article L631-7 du Code de commerce
(5) Article L631-18 du Code de commerce
(6) Article L631-14 du Code de commerce
(7) Article L631-12 du Code de commerce
(8) Article L631-1 du Code de commerce
(9) Article L631-14 du Code de commerce
(10) Article L3253-2 du Code du travail
(11) Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice

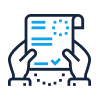


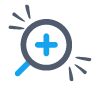


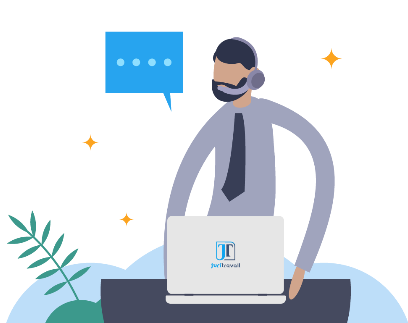




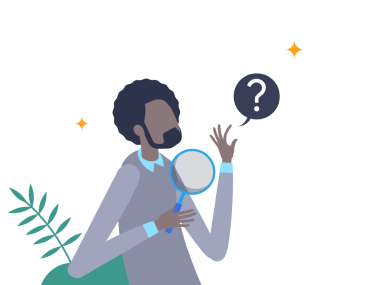

Réponses claires et sourcées Parfait