Qui est concerné par l'information et l'affichage obligatoires en entreprise relatif au harcèlement sexuel ?
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner."
Article L1153-5 du Code du travail
Selon une enquête sur le harcèlement sexuel au travail menée par le Défenseur des droits, les femmes sont les plus exposées à ces actes répréhensibles : 1 femme sur 5 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel dans le monde professionnel (1).
Pour prévenir et lutter contre ces comportements en entreprise, tout employeur de droit privé doit respecter les dispositions relatives aux affichages et communications obligatoires en la matière (2).
Selon le Code du travail, l'employeur doit informer les salariés de la réglementation applicable, des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes et des coordonnées des autorités et services compétents (3).
L'objectif de cette obligation d'information est double :
- informer les victimes de leurs droits à agir contre leur agresseur ;
- prévenir et dissuader les agissements sexistes et le harcèlement sexuel.
🔍 À lire aussi : Harcèlement sexuel au travail : 10 exemples pour réagir
Quels sont les affichages obligatoires en entreprise concernant la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel au travail ?
Le cadre légal de l'information relative au harcèlement sexuel
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, l'employeur doit informer (3) :
-
du texte de l'article 222-33 du Code pénal définissant l'infraction de harcèlement sexuel ;
-
des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel ;
-
et des coordonnées des autorités et des services compétents, dont la liste est définie par le Code du travail.
L'employeur doit informer les salariés, mais aussi les stagiaires, les candidats au recrutement pour un poste, un stage ou une formation ainsi que les personnes en formation.
Information obligatoire du cadre légal sur le harcèlement sexuel : l'article 222-33 du Code pénal
Définition du harcèlement sexuel
Tout d'abord, les salariés doivent être informés du contenu de l'article 222-33 du Code pénal qui précise :
- la définition du harcèlement sexuel, définition reprise par le Code du travail ;
- et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel (4).
Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante."
Article 222-33 du Code pénal
Propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste
Ce texte prévoit que l'infraction de harcèlement sexuel est caractérisée lorsqu'une personne impose à une autre, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui :
- soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;
- soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
Harcèlement de groupe
Le harcèlement de groupe a également été inclus au sein de cette définition définissant le harcèlement sexuel (5). Ainsi, l'infraction est aussi constituée dans les 2 cas suivants :
- lorsque ces propos ou comportements sexistes sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
- lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Pression grave
Est aussi assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Outrage sexiste ou sexuel
Depuis le 1er avril 2023, l'outrage sexuel et sexiste aggravé, qui était jusqu'alors une contravention, est devenu un délit puni de 3.750 euros d'amende (6).
Il est définit par l'article 222-33-1-1 du Code pénal.
Concrètement, l'outrage sexiste ou sexuel est caractérisé par le fait d'imposer à une personne tout propos ou agissement à connotation sexuelle ou sexiste qui :
- soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant ;
- soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Il est aggravé dès lors qu'il est exercé par certaines personnes, notamment par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (par exemple, un supérieur, l'employeur, etc.).
Ce texte ne fait pas l'objet d'une obligation d'information, mais rien n'interdit l'employeur de mener des actions de prévention sur cette thématique.
Information sur les peines encourues en cas de harcèlement sexuel avéré
2 ans de prison
Par ailleurs, l'employeur doit rappeler aux salariés quelles sont les sanctions applicables lorsque les faits de harcèlement sexuel sont avérés. Ces peines sont prévues au sein de l'article 222-33 du Code pénal.
Ainsi, l'employeur doit prévenir les travailleurs que les faits de harcèlement sexuel constituent un délit puni de 2 ans de prison et 30.000 euros d'amende.
Les peines peuvent être portées à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende :
- en cas d'abus d'autorité (c'est notamment le cas lorsque l'auteur des faits de harcèlement sexuel est un supérieur hiérarchique) ;
- ou lorsque les faits de harcèlement sexuel sont commis sur une personne dite vulnérable (salarié en situation de handicap, salariée en état de grossesse, salarié malade...).
🔍 À lire également : Harcèlement managérial : 5 solutions pour y mettre fin
Information obligatoire sur les actions contentieuses et coordonnées des services compétents (référent CSE, médecine du travail, etc.)
Enfin, l'employeur doit informer les salariés des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel : saisir le conseil de prud'hommes, porter plainte à la police ou la gendarmerie, etc. Notre modèle d'affichage vous accompagne pour informer votre salarié des recours qui lui sont possibles.
En plus, il doit leur communiquer les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) des autorités et des services compétents (7) :
- le médecin du travail ou le service de prévention et de santé au travail compétent pour l'établissement ;
- l'inspection du travail compétente et le nom de l'inspecteur compéten ;
- le Défenseur des droits ;
- le référent harcèlement sexuel désigné par les membres du comité social et économique (CSE) (dans les entreprises qui comptent au moins 11 salariés) ;
- le référent harcèlement sexuel en entreprise (dans les entreprises qui comptent plus de 250 salariés) (8).
Comment réaliser une affiche contre le harcèlement sexuel ? Découvrez notre modèle de panneau harcèlement pour les entreprises en 2025 !
Une information par tout moyen
Depuis 2017, la réglementation relative aux affichages obligatoires en entreprise a été assouplie. Certaines informations ne doivent plus obligatoirement être affichées au sein de l'entreprise, mais peuvent être communiquées, par tout moyen, aux salariés (9).
C'est le cas des informations relatives au harcèlement sexuel, qui peuvent être communiquées aux salariés par tout moyen : note de service, intranet de l'entreprise, etc. (10).
Information présente au moins dans les lieux de travail ou à la porte des locaux dans lesquels se fait l'embauche
Néanmoins, l'affichage reste le meilleur moyen de s'assurer que toutes les personnes concernées puissent avoir accès à l'information, étant donné que cette information doit être faite :
- dans tous les lieux de travail ;
- ainsi que dans les locaux (ou à la porte des locaux) où se fait l'embauche.
L'employeur peut donc, s'il le souhaite, continuer à afficher sur un panneau, les informations relatives au harcèlement sexuel en entreprise.
En plus de conserver des affichages à jour dans les locaux, l'employeur peut également faire le choix de multiplier les moyens de communication et les diffuser également sur l'intranet ou par courriel, par exemple.
Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de l'information obligatoire sur les textes de loi relatifs au harcèlement sexuel ?
L'employeur qui ne respecte pas ses obligations en matière d'information sur le harcèlement sexuel s'expose à une peine d'amende.
Vos manquements pourront être constatés en cas de contrôle de l'inspection du travail.
L'employeur peut engager sa responsabilité civile et pénale si des faits de harcèlement se produisent et qu'il n'a mis aucune mesure en place pour prévenir de tels faits. Il s'agirait d'un manquement à son obligation de santé et de sécurité (11).
🔍 Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cet article : Défaut d'affichage obligatoire ou d'information : quelles sanctions ?
Comment prévenir le harcèlement en entreprise ? Visionnez notre webconférence animée par notre juriste experte
Références :
(1) "Enquête sur le harcèlement sexuel au travail", études et résultats du Défenseur des droits, mars 2024, données reprises dans "Discrimination et harcèlement sexuel dans l'emploi privé et public : recueil du signalement et enquête interne", décision-cadre du Défenseur des droits, février 2025
(2) Article L1111-1 du Code du travail
(3) Article L1153-5 du Code du travail
(4) Articles 222-33 du Code pénal et L1153-1 du Code du travail
(5) Loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
(6) Article 222-33-1-1 du Code pénal ; Décret n°2023-227 du 30 mars 2023 relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel
(7) Article D1151-1 du Code du travail
(8) Article L1153-5-1 du Code du travail
(9) Décrets n°2016-1417 et n°2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
(10) Article L1153-5 du Code du travail
(11) Article L4121-1 du Code du travail

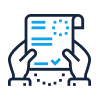



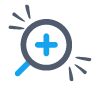



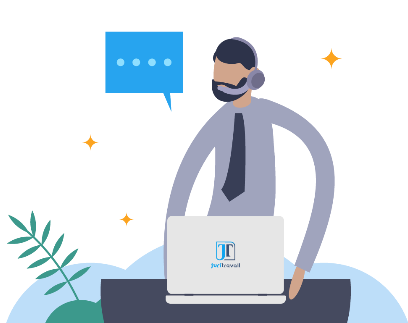




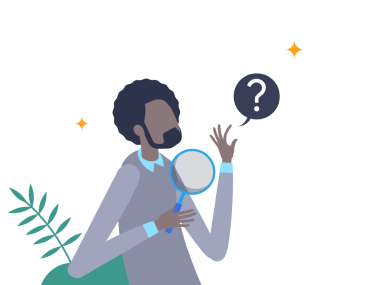

Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement