Trouvez immédiatement un avocat compétent en droit de la santé disponible près de chez vous pour vous conseiller sur notre annuaire d’avocats, ou bien demandez gratuitement des devis à des avocats proches de chez vous !
Droit de la santé : les contenus de Juritravail pour toutes vos démarches juridiques
Le droit de la santé régule les relations entre les professionnels de la santé, les patients et les institutions médicales. Il établit les normes éthiques et juridiques entourant les soins de santé, la confidentialité médicale et les responsabilités des professionnels.
Le droit de la santé protège les droits des patients, garantit l'accès aux soins et définit les procédures en cas de litige médical.
Protégez votre bien-être et votre santé et naviguez sereinement dans le domaine complexe du droit de la santé. Découvrez l'actualité juridique décryptée par nos juristes et avocats partenaires ainsi que des documents juridiques pour vous éclairer sur vos droits.

Affiner votre recherche :
Supprimer tous les filtres
Maladie professionnelle et licenciement pour inaptitude : jurisprudence du 10 septembre 2025
Rédigé par Maître Ariane DE MONTLIBERT, mis à jour le 29/10/2025
Lorsqu’une maladie est liée au travail, peuvent se croiser le droit de la sécurité sociale et le droit du travail. Cette distinction devient essentielle lorsque le salarié est licencié pour inaptitude.
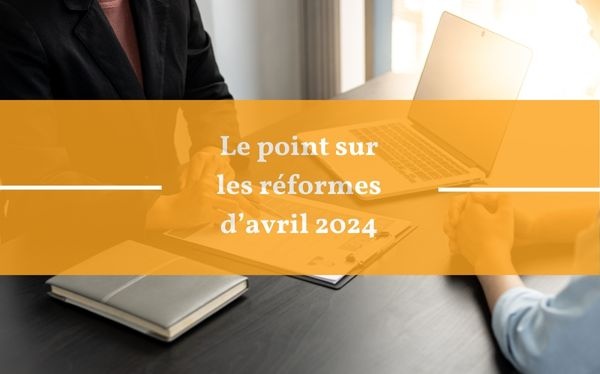
Employeur, qu'avez-vous manqué en avril 2024 ? Le point sur les réformes et celles à venir !
Rédigé par Rédaction Juritravail, mis à jour le 30/04/2024
Comme depuis le début de l'année, le mois d'avril 2024 a été riche en nouveautés. Qu’est-ce qui a changé pour les professionnels ? Quelles sont les réformes marquantes de ce mois d'avril ? Quels sont les changements à venir en mai 2024 et qui pourraient vous impacter ? Voici un récap des grands changements d'avril 2024 et de ceux à venir !

Cession totale ou partielle d’un fonds libéral infirmier, comment ça marche ?
Rédigé par Maître Laurent LATAPIE, mis à jour le 08/04/2024
Les infirmiers en charge de leurs patientèles sont en mesure de procéder à la cession totale ou partielle de leur fonds libéral d’infirmier. Comment ça marche ? Quels sont les clauses, démarches et éléments à ne pas oublier ? Que faire en cas de litige ?

Employeur, qu'avez-vous manqué en février 2024 ? Le point sur les réformes et celles à venir !
Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 29/02/2024
Le mois de février 2024 a été riche en nouveautés. Qu’est-ce qui a changé pour les professionnels ? Quelles sont les réformes marquantes de ce mois de février ? Quels sont les changements à venir en mars 2024 et qui pourraient vous impacter ? Voici un récap des grands changements de février 2024 et de ceux à venir !
Demande de consultation du dossier médical
Rédigé par L'équipe Juritravail, mis à jour le 17/06/2024
0,00€
Vous souhaitez demander la transmission ou la consultation de votre dossier médical par un établissement ou un professionnel de santé.
Vous pourriez être intéressé par ces documents
- Les étapes de la rupture conventionnelle : négocier son indemnité et comprendre la procédure
- Bénéficier des allocations chômage : vos droits, calcul et démarches
- Victime de harcèlement moral au travail : comment le prouver et agir ?
- Entreprise de moins de 50 salariés : guide complet des affichages obligatoires
- Rupture conventionnelle avec un salarié : maîtrisez la procédure étape par étape
- Tout savoir sur le cumul emploi et retraite : procédure, modèle de lettre...
- Je suis inapte au travail : quels sont mes droits et la procédure applicable (obligation de reclassement, licenciement...) ?
- Le guide pour rédiger pas à pas votre Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels
- Affichages obligatoires dans les entreprises + de 50 salariés : tout savoir
- Comment bénéficier des allocations chômage après une démission ?
- Lettre de demande de rupture conventionnelle (CDI) par le salarié
- Modèle document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)
- Lettre de notification d'un avertissement au salarié
- Modèle de licenciement du salarié à domicile (décès de l'employeur)
- Modèle de CDI à temps plein
- Modèle de lettre de démission d'un CDI
- Lettre informant l’employeur d’un départ volontaire à la retraite
- Lettre de mise en demeure pour abandon de poste
- Modèle de règlement intérieur d'entreprise (+ lettre de dépôt à l'inspection du travail)
- Lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
- Panneau d'affichage obligatoire 2025 : solution tout-en-un
- Syntec
- Transports routiers et activités auxiliaires du transport
- Hôtels, cafés restaurants
- Commerces de gros
- Ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés
- Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, contrôle technique automobile
- Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire
- Entreprises de prévention et de sécurité
- Entreprises de propreté et services associés




Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement