Selon votre besoin, Juritravail vous propose deux services :
- consultez un avocat disponible immédiatement par téléphone,
- ou bien recevez des devis d'avocats compétents près de chez vous afin de rencontrer celui qui vous convient.

Affiner votre recherche :
Supprimer tous les filtres
Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 06/02/2026
Votre contrat de travail a été rompu suite à un licenciement, une rupture conventionnelle ou parce que vous avez démissionné. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester sans revenus. Pouvez-vous prétendre au versement des allocations chômage ? Quelles sont les conditions à remplir pour percevoir l'allocation chômage, aussi appelée allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE),...

Rédigé par Noa Lelaidier, mis à jour le 06/02/2026
Divers dispositifs de retraite anticipée permettent à un salarié de partir en retraite avant l'âge légal, par exemple parce qu'il a eu une carrière longue ou parce qu'il souffre d'un handicap. En tant qu'employeur, pouvez-vous vous opposer à une demande de retraite anticipée ? Quelles sont les démarches que vous devez effectuer ? Tour d'horizon des informations que vous devez...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 06/02/2026
Vous envisagez de proposer une rupture conventionnelle individuelle à plusieurs de vos salariés. Vous vous demandez combien de ruptures conventionnelles vous pouvez faire ? Dans quelles situations un nombre élevé de ruptures conventionnelles peut alerter l'inspection du travail et être assimilé à un contournement de règles protectrices pour les salariés ? Ou, l'un de vos salariés...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 06/02/2026
Les contrats aidés visent à faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. En contrepartie de leur embauche, l'employeur bénéficie de dispositifs d'aide particuliers. Quels sont les principaux contrats aidés ? Qui peut en bénéficier ? Quel salaire verse l'employeur et quelle aide perçoit-il ? Voici un...

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 06/02/2026
Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les salariés peuvent être amenés à engager des frais professionnels. L'employeur doit alors prendre à sa charge les dépenses exposées par ses salariés. Quels sont les frais professionnels qui doivent être remboursés par l'employeur ? Quelle méthode choisir pour les rembourser : sur la base des dépenses réellement engagées par le...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 06/02/2026
Le compte personnel de formation (CPF) permet aux travailleurs indépendants, comme aux salariés, de suivre une formation certifiante qui leur permettra d'augmenter leur niveau de qualification ou encore d'effectuer un bilan de compétences en vue, notamment, d'une reconversion professionnelle. En tant qu'employeur, vous souhaitez connaître vos obligations en matière de CPF pour répondre...

Rédigé par Noa Lelaidier, mis à jour le 06/02/2026
L'arrivée d'un nouveau-né au sein d'un foyer est source de nombreuses dépenses pour les familles (achat de matériels de puériculture, mobiliers, vêtements...). Afin d'aider les ménages à supporter le coût financier de ces frais, la Caisse d'allocations familiales (CAF) verse une prime à la naissance à certains d'entre eux. Qu'est-ce que la prime de naissance ? Quelles sont les...

Rédigé par Noa Lelaidier, mis à jour le 06/02/2026
En tant que chauffeur pour une société de déménagement, de transport scolaire, conducteur de transports de marchandises ou de voyageurs, vous relevez de la Convention Collective Nationale des transports routiers (IDCC 16). Cette convention vous permet de bénéficier de certains avantages, comme le congé de fin d'activité (CFA), pour anticiper votre départ à la retraite. Conditions,...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 05/02/2026
L'un de vos salariés s'apprête à partir en retraite et vous avez décidé d'anticiper son départ en vous posant les bonnes questions : procédure à suivre, droits du salarié, indemnité à verser... Quelles sont les étapes obligatoires à respecter pour remplir vos obligations légales ? Quel ordre suivre, et quels pièges éviter ? Réponses !

Rédigé par Cabinet Alexandre MARCHAND, mis à jour le 05/02/2026
Le contrat, qu’il soit civil ou commercial correspond à la résultante de deux volontés concordantes, d’où découlent des droits et obligations pour les deux parties. Le contrat implique des conditions de formation, qui en cas de manquement, peuvent être sanctionnées par la nullité, qui est la sanction la plus dure, se rapportant à un contrat et ce sera le sens de cette note.

Rédigé par Cabinet Ziegler et Associés, mis à jour le 05/02/2026
Les arnaques financières ne sont plus seulement un problème individuel relevant de la prudence personnelle. Elles sont devenues un enjeu systémique, impliquant de multiples acteurs : fraudeurs bien sûr, mais aussi banques, plateformes de paiement, prestataires techniques et intermédiaires financiers. Pendant longtemps, le discours dominant a consisté à faire peser la responsabilité...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 05/02/2026
Vous êtes employeur dans une boulangerie-pâtisserie artisanale et vos salariés souhaitent prendre des vacances ou ont besoin d'un jour de congé pour un motif personnel ? Vérifiez quelles sont les dispositions particulières prévues par la Convention collective nationale (CCN) Boulangerie-Pâtisserie en matière de congés et jours fériés. Combien de jours de congés payés les...

Rédigé par Noa Lelaidier, mis à jour le 05/02/2026
Vous faites l'objet d'une procédure de licenciement économique et votre employeur vous propose d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Qu'est-ce que le CSP et quel avantage a-t-il ? Comment êtes-vous rémunéré pendant la durée du CSP ? Comment en bénéficier ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur le contrat de sécurisation professionnelle.
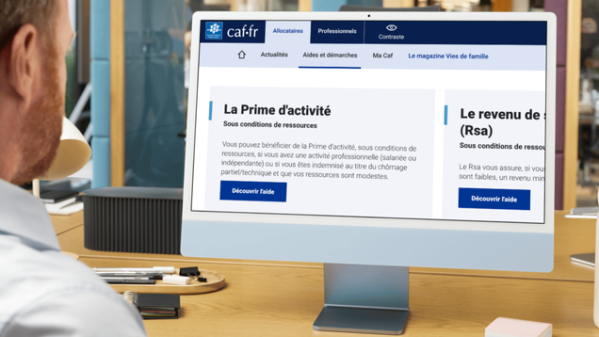
Rédigé par Paul Augustin Cissé, mis à jour le 05/02/2026
Vous entendez régulièrement parler des minima sociaux, des prestations sociales ou encore de la prime d'activité autour de vous. Cependant, vous ne savez pas exactement à quoi cela correspond ? Qui peut en bénéficier ? Quels sont leurs montants respectifs ? Tour d'horizon !

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 05/02/2026
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'ordre du jour est établi avant chaque réunion du comité social et économique (CSE). Il est important de le préparer bien en amont, car il permet aux membres d'assurer effectivement l'expression collective des salariés et la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions de l'entreprise. Préparation, rédaction, communication :...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 05/02/2026
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, tous les employeurs du secteur privé sont tenus de proposer à leurs salariés une mutuelle d'entreprise, qui intervient en complément du remboursement des frais de santé opéré par l'Assurance maladie. Quelles sont vos obligations en la matière ? Que risquez-vous, en cas de non-respect de la règlementation applicable ? Contrôle Urssaf, redressement... On...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 05/02/2026
Vous envisagez de licencier un salarié ? Quels sont les types de licenciement possibles ? Quel motif de licenciement choisir (licenciement pour motif personnel ou licenciement pour motif économique) ? Quel est le coût pour votre entreprise ? Quels sont les risques ? Voici un panorama des différents motifs de licenciement pour vous aider à prendre une décision.

Rédigé par Clémentine Fontaine, mis à jour le 05/02/2026
Les contrats commerciaux constituent le socle des relations commerciales que les entreprises établissent dans le cadre de leur activité. Cette notion, plus complexe qu'il n'y paraît, obéit, selon les cas, à un régime juridique que l'on peut qualifier d'hybride, entre le droit civil et les spécificités du droit commercial. Comment définir un contrat commercial ? Quelles sont ses...

Rédigé par Valentin Bosseno, mis à jour le 05/02/2026
Prestations adaptées, responsabilités limitées, cadre légal sécurisant, etc. : le portage salarial est une alternative à l'embauche permettant d'avoir accès à un salarié porté, dans le but de palier un défaut d'expertise afin de réaliser une tâche précise au sein de votre entreprise. Quels sont les métiers qu'il est possible d'exercer en portage salarial ? Comment...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 05/02/2026
Si vous travaillez dans le secteur social ou médico-social, cette actualité vous présente de manière synthétique et actualisée les principaux points essentiels de la Convention collective 66, ainsi que les avantages qu’elle offre aux salariés comme aux employeurs.

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 05/02/2026
Les congés payés peuvent faire l'objet d'un fractionnement. Qu'est-ce que le fractionnement des congés payés et qu'est-ce que cela implique ? Le fractionnement du congé principal donne-t-il droit à des jours de congés supplémentaires ? L'accord des parties est-il nécessaire pour fractionner les congés payés ? Quelles exceptions aux congés supplémentaires pour fractionnement ?...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 04/02/2026
CDI senior, entretien de parcours professionnel, négociation sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés... Ces notions ne vous disaient peut-être rien il y a quelques mois, mais font désormais partie de la réalité de votre entreprise. C'est en tout cas l'objectif de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels (ANI) en faveur de l'emploi des...

Rédigé par Noa Lelaidier, mis à jour le 04/02/2026
Le congé paternité permet au père salarié ou au conjoint de la mère (ou au concubin, ou à la personne liée à elle par un Pacs ou vivant maritalement avec elle), de profiter de l'enfant et de la maman dans les jours ou semaines qui suivent sa naissance. Quelle est la durée de ce congé ? Quand et comment en faire la demande ? Comment le salarié est-il indemnisé ? On vous dit tout !

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 04/02/2026
Que vous soyez employeur ou salarié d'une entreprise de transport routier de marchandises, de transport routier de voyageurs, de transport de déménagement, de transport sanitaire ou encore de prestations logistiques, vous relevez de la Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. Classifications, salaires, primes, durée de la période d'essai ou...

Rédigé par Noa Lelaidier, mis à jour le 04/02/2026
Vous intervenez auprès des mineurs et adultes handicapés en protection sociale/jeunesse ? Vous accompagnez des personnes en difficultés sociales ? Vous relevez certainement de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, communément appelée "Convention 66". Nous faisons le point sur les dispositions prévues par votre convention...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 03/02/2026
Le métier que vous exercez ne répond plus à vos attentes. Vous avez envie de changer de cap et vous envisagez une reconversion professionnelle. Pourquoi ne pas donner un nouveau souffle à votre carrière professionnelle en réalisant un bilan de compétences ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir à ce sujet !

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 03/02/2026
Le secteur de la coiffure relève de la Convention collective nationale (CCN) de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (IDCC 2596), qui prévoit des dispositions particulières en matière de jours fériés. Un employeur de ce secteur peut-il envisager d'ouvrir son salon et de demander à ses salariés de travailler un jour férié ? Réponse !

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 03/02/2026
Le mois de janvier 2026 a été marqué par plusieurs évolutions juridiques ! En tant qu'employeur, ou membre du service RH, vous devez impérativement connaître toutes les évolutions qui pourraient impacter votre activité ! Qu'avez-vous manqué depuis le début d'année ? Juritravail revient sur les actualités juridiques essentielles du mois de janvier 2026 !

Rédigé par Paul Augustin Cissé, mis à jour le 03/02/2026
Votre enfant de 6 à 18 ans a fait sa rentrée scolaire et les frais à engager vous inquiètent ? Vous remplissez peut-être les conditions requises pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Cette aide financière peut vous aider à couvrir une partie des dépenses de la rentrée. Détails et explications !

Rédigé par Sessi Imorou, mis à jour le 02/02/2026
Votre salarié ne supporte plus son travail, une tâche en particulier ne l'enchante peut-être plus, il n'a plus envie d'obéir à vos recommandations ? Vous y voyez une insubordination ? L'insubordination du salarié peut être lourde de conséquences. Vous pouvez sanctionner cette indiscipline, voire décider de licencier pour faute. Dans certains cas, le licenciement pour faute grave est...
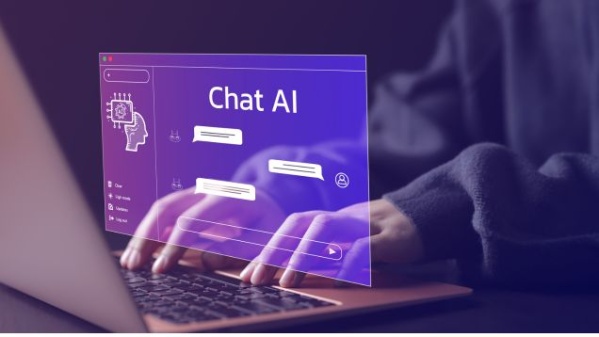
Rédigé par Kevin Lemoyec, mis à jour le 02/02/2026
Si 2025 s'est imposée comme l'année du développement technologique massif des Intelligences Artificielles (IA), avec des investissements colossaux dans des modèles de langage comme ChatGPT, Gemini ou Mistral AI, l'année 2026 marque un tournant opérationnel avec une intégration concrète de l'IA dans de nombreux secteurs d'activité. Toutefois, ce virage technologique ne se fait pas sans...

Rédigé par Paul Augustin Cissé, mis à jour le 02/02/2026
La rentrée des classes est un moment particulier pour les salariés qui ont des enfants. Vous avez déjà reçu des demandes d'absence ou d'aménagement d'horaires de la part de salariés parents pour le jour de la rentrée scolaire : devez-vous forcément les accepter ? De quelle marge de manœuvre disposez-vous en la matière ? Quels réflexes adopter ? Comment anticiper ce moment ?...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 30/01/2026
Vous avez été victime d’un accident ou d’une maladie non professionnelle et avez été reconnu invalide. Votre capacité de travail s’en trouve réduite, entraînant une baisse de revenus. Pour compenser cette perte, vous pouvez prétendre à une pension d’invalidité. On vous dit tout à ce sujet !

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 30/01/2026
Si l'évaluation des risques de l'entreprise est faite sous la responsabilité de l'employeur, le Comité social et économique (CSE) est aussi un acteur incontournable dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) . Quel est le rôle du CSE vis-à-vis de l'élaboration et de la mise à jour du DUERP ? Faisons le point ensemble.

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 30/01/2026
Le report des congés payés non pris par le salarié n'est pas toujours possible. En principe, lorsque le salarié ne prend pas ses jours de congés avant la date limite fixée par son entreprise, il les perd. Néanmoins, des cas exceptionnels permettent le report des jours qui n'ont pas été posés. Dans quels cas le report des congés payés est-il possible ? Pendant combien de temps...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 30/01/2026
Lors de la rupture de son contrat de travail, le salarié peut prétendre à différentes indemnités, dont l'indemnité compensatrice de congés payés. L’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) est due quand un salarié n’a pas pris tous ses congés à la fin du contrat. Dans quels cas est-elle versée ? Le mode de rupture influe-t-il sur son versement ? Quelle est la formule...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 29/01/2026
La question de l'acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie et du report des congés payés non pris en raison d'un arrêt de travail, a fait l'objet d'une jurisprudence de la Cour de cassation mettant fin à certaines divergences existantes entre le droit français et le droit européen en la matière, obligeant le législateur français à revoir sa copie. C'est chose faite,...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 29/01/2026
Le 14 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, dans l'espoir de faire adopter le texte avant la fin de l'année 2025. Pensé pour permettre de réduire le déficit public, celui-ci a donné lieu à de longs débats parlementaires. Que contient exactement ce PLF pour 2026 ? Quelles sont les mesures intéressant les entreprises ? Et les...

Rédigé par Sessi Imorou, mis à jour le 29/01/2026
Lorsque le salarié ne respecte pas ses obligations, l'employeur peut être contraint d'envisager de le licencier. Selon la gravité des faits, vous pensez à le licencier pour faute simple. Mais qu'est-ce qu'un licenciement pour faute simple ? Quelle procédure faut-il respecter et quelles indemnités devez-vous lui verser ? Explications.

Rédigé par Sessi Imorou, mis à jour le 29/01/2026
Le licenciement pour faute grave est une rupture du contrat de travail motivée par un comportement du salarié rendant impossible son maintien dans l’entreprise, sans préavis ni indemnité de licenciement. Pour l’employeur souhaitant engager un licenciement pour faute grave, il est indispensable de respecter rigoureusement la procédure prévue à cet effet et de pouvoir justifier...

Rédigé par Cabinet Ziegler et Associés, mis à jour le 29/01/2026
Les arnaques financières en ligne sont de plus en plus courantes et sophistiquées. Contrairement aux idées reçues, les arnaques financières ne reposent plus uniquement sur des promesses grossières ou des messages mal rédigés. Les fraudeurs utilisent désormais des sites professionnels, des discours juridiques ou techniques élaborés, et des stratégies psychologiques...

Rédigé par Cabinet Alexandre MARCHAND, mis à jour le 29/01/2026
Lorsque le contrat est conclu suite à un échange des consentements, il en résulte des droits et obligations pour les parties, que chacun doit exécuter amiablement et à défaut, la sanction judiciaire est possible et ce sera le sens de cette note.

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 29/01/2026
Les dates de départ en congés payés des salariés doivent être prévues à l'avance afin de permettre à l’employeur d’assurer la continuité de l’activité. Combien de jours de congés payés un salarié peut-il prendre ? Comment est fixée la période de prise des congés ? L'employeur peut-il établir un ordre des départs ? Peut-il refuser la demande de congés d'un salarié ou...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 29/01/2026
Au cours de la période d'essai, le salarié ou l'employeur peut rompre librement le contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Néanmoins, les droits du salarié en termes d'allocations chômage ne sont pas les mêmes, selon la partie à l'origine de la rupture, la date à laquelle elle intervient... et même la nature de la rupture de son précédent contrat de travail ! Alors, dans...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 29/01/2026
La rupture de la relation contractuelle à l’initiative de l’employeur peut intervenir dans des situations dans lesquelles le salarié a commis une faute lourde. Cette qualification repose sur des critères stricts. Mais comment déterminer si les faits reprochés à un salarié relèvent effectivement de cette catégorie de faute ? Quels sont les éléments qui permettent de caractériser...
Vous pourriez être intéressé par ces documents
Ils partagent leurs expériences
04/02/2026
Avoir un document des lois du travail pour les intérimaires
31/01/2026
A répondu à mes attentes sur la commande d'un ouvrage.