Selon votre besoin, Juritravail vous propose deux services :
- consultez un avocat disponible immédiatement par téléphone,
- ou bien recevez des devis d'avocats compétents près de chez vous afin de rencontrer celui qui vous convient.

Affiner votre recherche :
Supprimer tous les filtres
Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 19/12/2025
Noël approche à grands pas, et le Comité Social et Économique (CSE) et/ou l'employeur peuvent décider d'offrir des cadeaux aux salariés (bons d'achats, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux) pour cette occasion. Pour bénéficier des exonérations de cotisations sociales et éviter que ces montants ne soient inclus dans le revenu imposable des salariés, leur valeur ne doit pas dépasser un...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 19/12/2025
Le paiement des salaires est l'une des principales sources de contentieux portés devant le conseil de prud'hommes (CPH). Les entreprises doivent donc se montrer particulièrement vigilantes sur le sujet : comment fixer le salaire d'un salarié ? Quelles sont les obligations à respecter ? L’employeur peut-il récupérer un trop-perçu ou des primes versées par erreur ? On fait le point !

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 19/12/2025
Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (PLFSS 2026) a été présenté au Conseil des ministres et déposé au Parlement le 14 octobre 2025, malgré le contexte politique particulier. Ruptures conventionnelles, apprentissage, avantages sociaux, retraite, congé maternité, arrêts de travail, nouveau congé de naissance... Il a été adopté définitivement le 16...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 19/12/2025
Le 14 octobre 2025, Sébastien Lecornu a présenté le projet de loi de finances (PLF) pour 2026, dans l'espoir de faire adopter le texte avant le 1er janvier prochain. Pensé pour permettre de réduire le déficit public, l'examen du texte donne lieu à de longs débats parlementaires, et a commencé sa navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Que contient exactement ce PLF pour...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 18/12/2025
L'année 2026 s'annonce mouvementée pour les entreprises françaises avec la promulgation prochaine de la Loi de financement de la Sécurité sociale et de la Loi de finances pour 2026. Mais pas que ! Loi Seniors, transposition de la Directive sur la transparence salariale, réforme du financement de l'apprentisage... Découvrez quelques unes des réformes incontournables pour bien démarrer...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 18/12/2025
La rémunération des salariés constitue un élément essentiel de la relation de travail et du contrat de travail. Elle joue un rôle-clé pour engager, motiver et fidéliser les employés. L'employeur doit respecter de nombreuses règles pour gérer les rémunérations de ses salariés. Découvrez quels sont les éléments de rémunération, quelles sont les obligations légales et...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 18/12/2025
En mai, de nombreux jours fériés peuvent impacter l'activité de votre entreprise. Pour l'année 2026, il s'agit des 1ᵉʳ, 8, 14 et 25 mai 2026. Si le 1ᵉʳ mai est en principe un jour obligatoirement chômé et payé, qu'en est-il du 8 mai et du jeudi de l'Ascension ? Une majoration de salaire est-elle de droit pour les salariés qui travaillent ? Réponses dans cet article.

Rédigé par Cabinet Alexandre MARCHAND, mis à jour le 18/12/2025
Lorsqu’une personne décède, la question doit nécessairement se poser, de l’ouverture de sa succession, la mort traduit en effet la fin de la personnalité juridique et par là même, la transmission de son patrimoine. Qui est héritier de celui qui est décédé et comment s’opère la transmission de son patrimoine, sous la forme d’un héritage, et ce sera le sens de cette note.

Rédigé par Maître Michel Mizrahi, mis à jour le 18/12/2025
Dans le marché de l’automobile d’occasion, un simple voyant moteur peut devenir une véritable bombe juridique. Entre la garantie commerciale de trois mois, souvent limitée et rassurante en apparence, et la garantie légale de conformité, redoutablement protectrice depuis la réforme de 2021, l’acheteur découvre soudain qu’il détient une arme redoutable… ou qu’il s’en saisit...

Rédigé par Maître Michel Mizrahi, mis à jour le 18/12/2025
Le spoofing téléphonique, qui consiste à usurper le numéro d’appel officiel d’une banque pour tromper un client, s’est imposé comme l’une des fraudes bancaires les plus redoutables. Exploitant la confiance et l’urgence, les escrocs parviennent à faire valider des opérations frauduleuses en toute apparente légitimité. Longtemps, les banques ont rejeté toute responsabilité,...

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 18/12/2025
Vous souhaitez attribuer un avantage en nature à vos salariés en 2026, mais vous vous interrogez encore sur les différentes formes possibles ? Si une méthode d'évaluation en particulier existe ? Quels sont les barèmes Urssaf applicables en 2026 ? Juritravail fait le point pour vous et vous donne des exemples concrets !
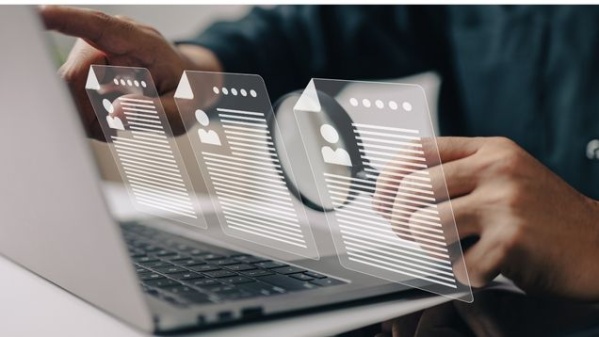
Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 18/12/2025
Le registre unique du personnel est un document que tout employeur doit produire pour assurer les statistiques des salariés de son établissement. Certaines mentions doivent obligatoirement y figurer sous peine de nullité. Ce registre doit également être tenu à disposition de l'inspection du travail pour un éventuel contrôle. Sa non-présentation ou sa mauvaise tenue peut donner lieu à...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 18/12/2025
La gestion des absences désigne l’ensemble des procédures mises en place pour administrer les différentes formes de congés. Une bonne gestion des absences suppose de les recenser et de les répertorier afin d'en anticiper les conséquences pour l'entreprise et de répondre aux obligations de l'employeur, qui en découlent : elle permet d'organiser le travail plus facilement, de...

Rédigé par Clémentine Fontaine, mis à jour le 18/12/2025
Vous avez entendu parler de contrats de partenariat commercial, mais vous ne savez pas exactement à quoi ce terme renvoie ? Pour bien comprendre de quoi il s'agit, et en quoi ce type de contrats peut s'avérer utile pour votre entreprise, il est important de définir leur cadre et le type de relations commerciales qu'ils ont vocation à encadrer. Nous faisons le point sur ce sujet !

Rédigé par Yoan El Hadjjam, mis à jour le 18/12/2025
Tourisme, santé, industrie, grande distribution... Pour des raisons spécifiques liées au secteur et à l'activité de votre entreprise, vos salariés sont amenés à travailler intensément certaines semaines, mais moins les semaines suivantes. Afin d'éviter d'avoir recours aux heures supplémentaires et au chômage partiel, vous souhaitez ne plus décompter leur temps de travail sur la...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 18/12/2025
Vous êtes employeur et vous souhaitez fermer votre entreprise pendant la période des fêtes. Quelles sont les démarches à effectuer pour fermer votre entreprise durant les vacances de Noël ? Pouvez-vous imposer des jours de congés à vos salariés ? Voici ce que vous devez savoir !

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 18/12/2025
L'entretien de parcours professionnel (anciennement l'entretien professionnel) est un levier indispensable pour mener une politique de management cohérente et gérer les ressources humaines de son entreprise. Ce rendez-vous obligatoire est en effet l'occasion pour vos salariés de vous parler de leur projet professionnel, et pour vous, l'opportunité d'optimiser les compétences au sein de...

Rédigé par Yoan El Hadjjam, mis à jour le 18/12/2025
Chaque année, le salaire minimum de croissance (SMIC) fait l'objet d'une revalorisation automatique afin de garantir le pouvoir d'achat des salariés. Ce minimum légal, applicable à la rémunération des salariés, est revalorisé au 1er janvier 2026 à hauteur de + 1,18 %. Juritravail vous dévoile les nouveaux montants et vous explique tout ce que vous devez savoir en la matière !

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 17/12/2025
Le Gouvernement a prévu la création d’un nouveau congé, appelé "congé supplémentaire de naissance" pour 2026. Ce nouveau congé s’inscrit dans une volonté de concilier la vie professionnelle et la vie familiale pour les parents actifs et favoriser l'égalité femme/homme. Découvrez quelles sont les caractéristiques de ce futur congé supplémentaire de naissance !

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 17/12/2025
La loi n°2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social a revu l'organisation de l'entretien professionnel. Celui-ci est devenu "l'entretien de parcours professionnel". Mais comment articuler cette nouvelle périodicité avec les anciens entretiens...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 17/12/2025
L'inflation, en augmentant le coût de la vie, nous donne le sentiment de perdre en pouvoir d'achat. Pour autant, peut-elle avoir un impact positif sur le montant de la rémunération des salariés du secteur privé ? En quoi l'inflation contraint-elle les entreprises à augmenter les salaires ? Nous faisons le point sur les estimations prévues pour 2026.

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 17/12/2025
Recruter dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) permet à l’employeur de favoriser l’accès à l’emploi de personnes en difficulté tout en bénéficiant d’aides financières. Un dispositif gagnant pour l’employeur, à condition d’en maîtriser les spécificités. Nous faisons le point sur les avantages et les inconvénients du CUI.

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 16/12/2025
Le budget de la Sécurité sociale a été adopté définitivement ce lundi 16 décembre 2025, aux alentours de 18h30. Ce texte fixe les grandes orientations en matière de santé, retraites, famille et accidents du travail pour l’année à venir, avec des impacts directs pour les salariés, les employeurs et les professionnels RH. 👉 Juritravail décrypte en temps réel les mesures...

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 16/12/2025
La fin d’année est souvent synonyme de récompenses et de reconnaissance pour les salariés au sein de leur entreprise. Dans la pratique, cela se matérialise par le versement d'une gratification, plus connue sous le nom de "prime de fin d’année". Mais à quoi correspond-elle exactement ? Qui peut en bénéficier ? Est-elle obligatoire ? On fait le point ensemble !

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 16/12/2025
Votre entreprise est touchée par un fort taux d'absentéisme et cela impacte nécessairement sa performance et sa compétitivité sur le marché. C'est pourquoi, en tant que chef d'entreprise, vous devez réagir au plus vite. Après en avoir identifié les principales causes, il vous faut mettre en place un plan d'action pour lutter contre l'absentéisme au travail de vos salariés. Nous...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 16/12/2025
Comme tous les ans, vous commencez à recevoir des demandes de stages, et l'embauche d'un stagiaire génère un certain nombre d'interrogations. Quelle rémunération de stage êtes-vous obligé de verser ? Devez-vous accorder des congés à votre stagiaire ? Quelle peut être la durée maximale d'un stage ? Quel est le nombre maximum de stagiaires autorisés dans votre entreprise ? On fait...

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 15/12/2025
La démission est une solution simple et rapide pour mettre fin à un CDI. Mais, en principe, démissionner ne vous permet pas de toucher le chômage. Vous craignez de vous retrouver sans salaire ? Sachez qu'il existe tout de même certains cas dans lesquels chômage et démission sont compatibles. Découvrez comment bénéficier des allocations chômage après une démission !

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 15/12/2025
Le budget du Comité Social et Économique (CSE) lié aux activités sociales et culturelles peut permettre aux élus d'offrir quelques cadeaux aux salariés de l'entreprise. Pourquoi ne pas en profiter pour leur offrir des chocolats à l'occasion des fêtes de Noël ? Découvrez de quel budget vous disposez à cette occasion.

Rédigé par Alexandra Marion, mis à jour le 15/12/2025
Longtemps non codifié, l'abandon de poste a pu permettre aux salariés de quitter volontairement leur emploi sous couvert d'un licenciement, et de percevoir, ensuite, les allocations chômage. Cette situation de fait pouvait se révéler injuste à l'égard des salariés contraints de démissionner, qui ne pouvaient pas prétendre à l'allocation de retour à l'emploi (ARE). Avec la volonté...

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 15/12/2025
Certains de vos salariés, notamment cadres, ont une charge de travail variable et effectuent régulièrement des heures supplémentaires. Vous souhaitez leur proposer de conclure une convention individuelle de forfait. Avec lesquels de vos salariés est-il possible de conclure cette convention ? Quelles sont les conditions à respecter ? Comment la mettre en œuvre ? Comment rémunérer vos...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 15/12/2025
Chaque année, à l'approche des fêtes de fin d'année, la prime de Noël est versée aux ménages ayant les revenus les plus modestes. Véritable coup de pouce de l'État pour aider à la préparation de Noël et du Nouvel An, elle est reconduite pour cette fin d'année 2025. Découvrez 6 informations à connaître pour en bénéficier !

Rédigé par Valentin Bosseno, mis à jour le 12/12/2025
La GEPP (Gestion des Emplois et Parcours Professionnels) est une évolution de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences). Cette approche met l'accent sur le parcours professionnel des individus en favorisant l'alignement entre les besoins du marché et les compétences des collaborateurs. Quels sont les enjeux ? Comment la mettre en place ? Quels impacts peut-elle avoir ?

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 12/12/2025
Vous faites le point sur le calendrier 2026 et vous vous interrogez sur le lundi de Pentecôte. Quand tombe-t-il cette année ? Est-ce que vous serez tenu de travailler ? Serez-vous payé ? Si, dans beaucoup d'entreprises, le lundi de Pentecôte est travaillé, car assimilé à la journée de solidarité, il est parfois chômé. Voici ce que vous devez savoir !

Rédigé par Valentin Bosseno, mis à jour le 12/12/2025
Vous venez d'obtenir un emploi et allez signer le contrat de travail. Soyez vigilant : les clauses qu'il contient vous engageront au moins aussi longtemps que durera la relation contractuelle. Salaire, clause de non-concurrence, période d'essai ou horaires de travail... Voici 6 points à vérifier avant de signer.

Rédigé par Alice Lachaise, mis à jour le 11/12/2025
Le plafond de la Sécurité sociale (PSS) est en principe revalorisé chaque année, en fonction de l’évolution des salaires. Le plafond a augmenté de 1,6% le 1er janvier 2025, et il devrait augmenter de 2% le 1er janvier 2026. Quels sont les nouveaux montants des plafonds de la Sécurité sociale (plafond annuel, mensuel, horaire, etc.) ? Comment est-il calculé ? Quelle est l'utilité...

Rédigé par Lorène Bourgain, mis à jour le 11/12/2025
Lorsqu'il s'agit de la gestion des comptes et de la conformité financière d'une entreprise, il est essentiel de distinguer les missions de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes (CAC). Si leurs interventions respectives touchent au même domaine, elles obéissent toutefois à une logique et à des objectifs bien différents : petit tour d'horizon des informations utiles à ce sujet !

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 11/12/2025
Instituée en 2004, la journée de solidarité (originellement, le lundi de Pentecôte) continue, chaque année et encore en 2026, de susciter des interrogations. Sachez que votre obligation principale, à vous, employeur, consiste à vous acquitter de la contribution qui y est associée. Pour le reste, nous faisons le point sur les questions essentielles à se poser !

Rédigé par Martial Moukagni-Nziengui, mis à jour le 11/12/2025
L'extrait K ou Kbis est un document très important pour toute entreprise dont l'activité est commerciale. Il constitue la preuve de l'inscription de celle-ci au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Ce document permet à l'entreprise d'accomplir de nombreuses démarches administratives et de prouver son existence légale. Qui est concerné par l'extrait Kbis ou K ? À qui s'adresser...

Rédigé par Paul Augustin Cissé, mis à jour le 11/12/2025
L’ouverture des magasins le dimanche se généralise, que ce soit pendant l’été pour accueillir les touristes ou à l’occasion des fêtes de fin d’année. Pourtant, travailler ce jour-là n’est pas automatique pour les salariés. La loi encadre strictement les conditions dans lesquelles ils peuvent être employés le dimanche, leurs droits et les obligations de l’employeur. Dans...

Rédigé par Valentin Bosseno, mis à jour le 11/12/2025
Cette année encore, les jours fériés vous permettront d'avoir un avant-goût de vacances ! En 2026, 3 jours fériés tombent en milieu de semaine, une occasion rêvée pour s'octroyer des week-ends prolongés. Mais alors, quels ponts faire en 2026 ? Votre employeur peut-il vous imposer de faire le pont ? Votre manager peut-il refuser votre demande de pont ? Comment êtes-vous rémunéré...

Rédigé par Clémence Gosset, mis à jour le 10/12/2025
À l'occasion des fêtes de fin d'année, de nombreux salariés et leurs enfants, bénéficient de bons d'achat et/ou de cadeaux de la part de leur entreprise. Mais qui les offre ? Est-ce que l'employeur et le CSE ont l'obligation de vous offrir des bons d'achat ou des cadeaux à Noël ? Comment les utiliser ? Tour d'horizon pour découvrir quelles sont les règles et comment vous faire...

Rédigé par Cabinet Alexandre MARCHAND, mis à jour le 10/12/2025
Les procédures dites « collectives » ont vocation à traiter des problèmes d’entreprises en grandes difficultés. Certaines de ces procédures collectives ont pour objectif d’assurer la survie de l’entreprise avec ou sans l’accord du chef d’entreprise, alors que d’autres procédures ont pour mission de faire disparaître l’entreprise, pour laquelle il n’existe plus de...

Rédigé par Caroline Audenaert Filliol, mis à jour le 10/12/2025
Vos conditions de travail se sont dégradées suite aux agissements d'un ou plusieurs collaborateurs (ou supérieurs hiérarchiques) : comment savoir s'il s'agit de harcèlement moral ? Quels sont vos recours ? Nous faisons le point.

Rédigé par Clémentine Fontaine, mis à jour le 10/12/2025
Vous êtes un professionnel et vous êtes amené à conclure divers contrats de prestation de services. Ceux-ci constituent un accord commercial par lequel un prestataire s’engage à réaliser une mission contre rémunération. Quelles mentions essentielles doivent-ils contenir ? Quels réflexes adopter dans le cadre de leur signature ? Définition du contrat de prestation de services,...

Rédigé par Aurélie Guillon, mis à jour le 10/12/2025
La rupture de la relation contractuelle à l’initiative de l’employeur peut intervenir dans des situations dans lesquelles le salarié a commis une faute lourde. Cette qualification repose sur des critères stricts. Mais comment déterminer si les faits reprochés à un salarié relèvent effectivement de cette catégorie de faute ? Quels sont les éléments qui permettent de caractériser...
Vous pourriez être intéressé par ces documents
Ils partagent leurs expériences
13/12/2025
Tout est très bien détaillé et présenté. Sauf que je recherche une réponse concernant : Après une rupture de contrat de travail de ma part en intérim, je suis allé voir mon médecin traitant quelques jours après parce que je me sentais...
10/12/2025
Adapté à mon besoin
05/12/2025
Le modèle est un peu trop chargé avec des pages inutiles avant et après le contenu pertinent.
02/12/2025
J'ai acheté la convention 2216 je suis satisfaite merci
30/11/2025
Bonjour juste pour aborder le harcèlement moral et syndical .Merci Cordialement